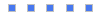

| Xavier Chanoine | 2.5 | Un millésime 2009 trop inégal |
La petite ritournelle qui accompagne le générique et les émotions des personnages du Lost in the Mountains d’Hong Sang-Soo a quelque chose de délicieusement ironique, faussement léger sans toutefois faire office de machine à ricanements face au sort réservé à la visiteuse. Alors bien sûr, les plus malins noteront que ce genre de ritournelle, on l’entend dans chaque Hong Sang-Soo. Normal, tout comme ces zooms et recadrages, également omniprésents depuis Turning Gate. Pourtant, chaque nouvel opus du cinéaste coréen, qu’importe sa longueur (ici réduite au format court-métrage pour les bienfaits du Jeonju Digital Project de 2009), apporte toujours quelque chose de nouveau. Pas d’un point de vue strictement formel, bien que l’on notera davantage de balayages et, éclatante révolution, une caméra embarquée en bagnole. Non, c’est plus dans sa peinture d’un milieu pourtant mille fois déjà-vu qu’Hong Sang-Soo fait mouche : on a beau trouver une nouvelle fois un professeur, des étudiants et écrivains, ceux-ci nous n’ont aucun mal à nous inviter à passer la demi-heure avec eux tant les situations se révèlent aussi bien piquantes que drôles.
Il y a d’abord le personnage de Mi-Sook, la visiteuse, débarquant sans rien dire à Jeonju pour revoir des têtes connues : son amie, un ex et une vieille connaissance avec qui elle pourra toujours prendre du bon temps en cas de blues. Nouveau carrefour de rencontres donc, bien que tous se connaissent déjà. On est à l’heure de mettre les points sur les i, d’expliquer ses agissements et états d’âme, de régler ses comptes entre amis, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’Hong Sang-Soo maîtrise une nouvelle fois, malgré le caractère mineur de l’oeuvre, l’art des montées en tension sans que l’on ne les attende. Il y a ces coups de téléphone où un professeur traite son ex de petite merde, celle-là même qui fera voler quelques noms d’oiseaux envers ses anciens camarades, tous un peu torchés. On tire aussi son coup, même si personne n’y voit aucune perspective particulière, on est chez Hong Sang-Soo en même temps. Et puis cette géniale inspiration en fin de métrage, où ces mêmes personnages alors en couple, installés à deux tables différentes, s’ignorent parce qu’ils ont quelque chose à se reprocher sur le plan sentimental. Avant que Mi-Sook et sa connaissance s’en aillent, le professeur, visiblement tendu, dit à son étudiante tout en fumant nerveusement une clope :
- - Tiens, ils s’en vont, ces pauvres merdes.
- - Je n’ai rien fait d’honteux ni de mal, vraiment. Elle sait à propos de nous…
- - Cet enfoiré continue de m’ignorer.
- - Tu sais que ça lui arrive d’être comme ça…
- - Comment ose t-il ne pas venir me saluer ? L’enfoiré. Regarde, il commande même un café…
Le règlement de compte qui suit, en dehors du restaurant, ramène aux géniales envolées nerveuses inattendues qui on forgées une partie de la réputation du cinéaste. Un imprévu qui symbolise tout ce que le cinéma d’Hong Sang-Soo continue d’apporter à la comédie de mœurs coréenne : ça pique et on en rit sans se gêner.
Plus introverti, Koma de Kawase Naomi nous ramène à une espèce de digestion pas très fine de ce que la cinéaste sait pourtant faire de mieux. Alors oui, il y a au départ ces plans de ciel, de verdure (et autres fleurs, classique), de montagne, et puis un banal récit sur le souvenir qu’un immigré coréen tente de retrouver en se rendant chez un proche de son grand-père. Là-bas, il fera la rencontre de la fille adoptive, mystérieux personnage profondément sensible. Mais cette sensibilité, la cinéaste la démolit en imposant une ligne formelle lourde : jamais la mise en scène ne semble être en accord avec la narration (quoique si, les flashbacks sont en sépia…), cette espèce de manie de vouloir à tout prix faire trembloter la caméra pour souligner une quelconque émotion instable dénote d’une certaine facilité pour une cinéaste qui nous avait habitué à mieux à ce niveau. Une scène de repas jusque là classique et posée devient même désagréable, c’est d’autant plus dommage car Kawase soigne sa lumière, par moments, à la perfection : le visage de Kitamura Kazuki trouve une belle complexité lorsqu’il est éclairé à la lanterne, les intérieurs ne sont alors plus aussi rassurants qu’ils paraissent à première vue, il s’en dégage une atmosphère plutôt grave qui ne motivera pas le visiteur à rester dormir. Mais il est trop tard pour rentrer, donc il restera. Un peu vaine comme expérience.
Reste de belles et rares séquences charnelles (la prestation chantée de l’actrice, les câlins, la cinéaste sait comment les filmer) et de bonnes idées, comme ce beau chant de Pansori que Kawase transpose dans un décor japonais (tout aussi beau), confrontant ainsi deux paysages au sein d’un même plan. Rapprochement des cultures, travail de mémoire sur les racines ? On n’oublie personne, même si c’est pour faire bien. Mais Kawase Naomi n’a jamais été du genre à oublier les siens, on l’a déjà vu avec ses beaux documentaires et long métrages contenant une part d’elle. Et même si le cinéma de Kawase ne peut pas se réduire qu’à une simple démonstration d’un certain intérêt pour l’humain, qui naît et pourrit comme une fleur n’est-ce pas (fleurs et feuilles qu’elle aime encore filmer comme des êtres à part entière), Koma donne la désagréable impression que Kawase, en manque d’un scénario suffisamment solide pour être pondu in real, recycle ses thèmes par petites touches histoire de toutes les compiler en trente minutes chrono.
On ne s’étendra pas sur le Lav Diaz, étonnamment moins accessible, plutôt moche, avec une histoire de glandeurs sous fond de kidnapping qui vire rapidement à l’ennui le plus total. Lav Diaz démontre qu’il a voulu la jouer austère jusqu’au bout, mais manque de pot, il vient après Kawase Naomi et Hong Sang-Soo. Drôle de choix.


