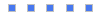Une excellente introduction à cette saga à succès
Premier opus de la série des "Torakku Yaro" lancée par Suzuki Norifumi en 1975 et comptant dix épisodes tournés sur cinq ans, "No one can stop me" est un road movie bien fait et empreint d'une véritable hystérie le rendant aussi bien attachant que parfois légèrement subversif, tout le talent du cinéaste, en somme. L'histoire est d'une simplicité déroutante, deux potes dévorent l'asphalte à bord de leur onze tonnes, n'ont pas de réel but dans la vie (l'un d'entre eux était d'ailleurs un ancien policier) et parcourent les coins du Japon pour se faire un peu d'argent partout où ils passent. Momojiro profite de la vie, des femmes, mais n'arrive pas à trouver l'âme sœur puisque seul son camion compte pour lui, à contrario de son pote, le bien nommé 5 Etoiles, marié et six enfants dont il n'arrive même pas à retenir le nom. La série des Torakku Yaro débute dans une époque où l'industrie cinématographique japonaise était en plein renouveau suite à la crise économique, où les cinéastes japonais avaient de plus en plus de mal à trouver des fonds (Kurosawa, Gosha...). Pour survivre face aux dangers, il était bon ton de trouver une nouvelle mascotte, une nouvelle série capable d'être à la fois intéressante sur le plan commercial et purement ludique. Ce premier épisode est donc un condensé de ce que l'on peut trouver de mieux dans le genre film d'exploitation à succès, et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'il acquerra rapidement un statut de série culte au même titre que le Tora-san de Yamada Yoji dont il partage une ou deux caractéristiques essentielles du cinéma d'exploitation, de commande, de tout ce que vous voulez : la programmation est une fois de plus estivale, comme Tora-san, les épisodes sont diffusés par la Toei durant les fêtes (très souvent en hiver et en été). Au niveau des thématiques abordées, le film surfe allègrement sur son côté à la fois burlesque et romantique, et comme tout bon film d'exploitation, un thème fort ressort afin de faire tourner la machine : ici, on "exploite" les camions. A la fois moteurs du film, acteurs, armes, instruments, tout est bon pour à la fois mêler violence urbaine et mélodrame larmoyant que la ménagère de moins de cinquante ans adore par dessus tout, le cocktail est donc parfait pour lancer une franchise à succès, redoutable d'efficacité car honnête dans ses propos et ne se moquant pas vraiment du client sur la marchandise malgré les relents inhérents du cinéma d'exploitation lorsqu'il est filmé par un cinéaste aussi inégal que Suzuki Norifumi, évoluant ici en terrain parfaitement inconnu. Adieu les nones et les karatekas, place à deux loustics pas plus intelligents ni forts qu'un autre, mais simplement deux hommes au grand coeur avec leurs qualités et défauts : l'un peut paraître le bon pote grassouillet drôle mais sans aucun espoir d'amour, réduisant ainsi son importance à l'écran face à Sugawara Bunta campant le rôle de Momojiro, tout de suite plus intéressant car doté d'une courbe d'évolution en constante hausse. Il est, qu'on le veuille ou non, le personnage central du récit, alternant les conquêtes amoureuses malgré lui qui ne déboucheront à pas grand chose de bien concret.


Prenons l'exemple de Tora-san, si Torajiro trouve l'amour dès le premier opus, Yamada Yoji peut fermer boutique et remballer gentiment ses valises. Torakku Yaro est dans la même veine, il vit parce que ses protagonistes essuient les échecs (Momojiro ne fera pas long feux avec Okyo, conductrice du poids lourd "Mona Lisa" en référence à la Joconde, parce que cette dernière trouvera l'amour ailleurs, il ne trouvera pas non plus son bonheur avec Yoko, serveuse dans un restaurant qui en pince encore pour son ex petit ami) et au spectateur alors de s'attacher à son personnage. Comment ne pas faire autrement d'ailleurs, lorsque l'on voit la performance assez hallucinante d'un Sugawara Bunta endiablé et pathétique dans la peau d'un macho grande gueule? Son ami, l'excellent Aikawa Kinya, est son alter ego gaffeur mais toujours motivé pour casser la baraque (la séquence où ce dernier renie complètement son ancien métier de policier est aussi bis dans son traitement que fondamentalement émouvante), le passager d'un jour n'a pas grand intérêt mais participe à la séquence la plus touchante du film, lorsqu'il répète à son insu, micro ouvert, sa déclaration à Okyo et se fait par la suite chahuté méchamment par les clients d'un restaurant. C'est ce qu'on appelle du cinéma imparfait, parfois raté comme sublimé par des passages furieux concoctés par Nakazawa Hanjiro à qui l'on doit notamment la photographie du Détroit de la Faim, Female Prisoner #701: Scorpion ou encore de quelques grands classiques de Fukasaku. On reconnaît effectivement sa caméra malmenée lors des affrontements entre Momojiro et les caïds de la route, distillant ça et là des cadres penchés, retournés et autres téléobjectifs imparfaits mais correspondants tellement à l'univers dépeint ici par Suzuki! La musique n'est pas en reste et sa signature d'époque est reconnaissable à des kilomètres. Alors certes ce premier opus n'est pas exempt d'incohérences au niveau du montage, d'intrigues sous-jacentes bâclées (l'histoire de la petite Yumi abandonnée par son père, l'avenir de Okyo...) et de tics trop récurrents au cinéma de genre à tendance nanar (Momojiro et son ami à la plage, aussi ringard qu'un mauvais film de Max Pécas), mais le plaisir éprouvé devant cette aventure humaine assumant pleinement son aspect commercial, convenu et larmoyant (à l'image des histoires d'amour Tora-sanesques) vaut bien quelques errances. Du grand Suzuki Norifumi, en somme.