Souvent ennuyeux malgré sa bonne narration
Tourné en 1985 alors dans la première période filmique du cinéaste, aussi bien au niveau formel que narratif,
Un temps pour vivre... ne se détache pas du lot des innombrables productions de même tenue, à savoir le portrait d'une famille modeste durant et après la guerre contre les communistes du pays. En seul fils narratif, la voix off de Ah-Hsiao, principal conteur et dynamiseur d'une histoire banale et pas si émouvante malgré la surenchère de tristesse émanant de l'oeuvre. Tout y passe, sur une période d'une dizaine d'années, et comme son nom l'indique, les jeunes vivent -ou tentent de vivre- malgré leurs difficultés et les vieux trépassent un par un. Joli programme. HHH chronique ce qu'il souhaite et son Taiwan n'est pas le plus reluisant que l'on connaît. De sa plume jaillissent un enfant "garçon" adopté des suites de deux naissances malencontreuses (deux filles, mal vu), une crapule qui passe son temps à défier la bande du Chat à coups de machettes et de provocations, une jeune fille incapable d'aller de l'avant, un père tuberculeux, une mère atteinte d'un cancer et une grand-mère perdue, difficile de voir quelconque optimisme dans l'entreprise d'HHH, malgré ses jolis moments lors de la période d'enfance d'A-Ha, bercés par la superbe musique de T'Chou T'Chou, mélodramatique et utilisée à bon escient. En revanche, malgré son absence de rythme et l'effet lacrymal joliment foiré,
Un temps pour vivre... arrive à capter l'attention et à délivrer un message sincère sans happy end vaseux ni second degré incertain.
Et c'est justement avec cette absence totale de mensonge envers son spectateur que HHH trouve ses limites, à contrario d'une Kawase Naomi qui filme le deuil et le déroulement d'une vie avec plus de grâce et d'émotion, et Lu Ye d'y trouver plus de sens dans les relations sentimentales des personnages, HHH ne reste qu'au constat et n'apporte pas la rigueur et l'anarchie de son cinéma des années 2000. En ressortent alors des séquences dramatiques, certes, mais longues et pénibles, des sous intrigues pas si évidentes (en dehors de certains personnages mal développés, l'histoire d'A-Ha n'est que survolée) et un pouvoir émotionnel qui aurait pu atteindre de plus hautes sphères (le père, son décès...). Mais comme tout bon cinéma d'auteur, potentiellement sélectionnable en festival, HHH ne prend aucun risque et signe avec Un temps pour vivre... une oeuvre souvent soignée et bien narrée, mais qui ne s'impose pas dans tous les domaines du film dramatique sous fond de faits réels. Pour du cinéma de même trempe, mais davantage inscrit dans le registre de la fiction, préférez le plus poétique cinéma de Kawase Naomi.
Un temps qui persiste, un temps qui disparait...
 Un peu moins abouti que ses deux précédents films, Un temps pour vivre, un temps pour mourir est néanmoins une étape capitale dans la grande oeuvre naissante d'Hou Hsiao Hsien. L'élargissement de perspective est en effet ici double. Les deux précédents Hou Hsiao Hsien évoquaient des évènements d'une durée limitée dans le temps alors que celui-çi embrasse une période temporelle plus longue. Qui plus est, le temps n'est plus cette fois celui de l'individu mais un temps historique scandé le long du film à coup de référence à l'actualité d'époque de Taïwan. De ce point de vue, le film esquisse l'idée de fresque de l'histoire de Taïwan vue à travers le prisme de la cellule familiale qui fera le sel de La Cité des Douleurs. La scénario inscrit d'ailleurs dans cette perspective historique le regard nostalgique du cinéma d'Hou Hsiao Hsien. La nostalgie qu'on certains membres de la famille, c'est celle d'une Chine continentale quittée mais vers laquelle on espère toujours revenir comme si le repli insulaire sur Taïwan devait n'etre que provisoire. Et au détour d'un plan on regrette ce membre de la famille laissé sur le continent finalement détruit par la Chine communiste. Mais le changement historique n'est pas la seule chose mettant à mal la cellule familiale ici. L'ordre naturel précipitant les membres les plus âgés de la famille vers la maladie ou la mort en est un tandis qu'en parallèle les enfants grandissent et finissent par ressentir sur le tard l'importance de la cellule familiale.
Un peu moins abouti que ses deux précédents films, Un temps pour vivre, un temps pour mourir est néanmoins une étape capitale dans la grande oeuvre naissante d'Hou Hsiao Hsien. L'élargissement de perspective est en effet ici double. Les deux précédents Hou Hsiao Hsien évoquaient des évènements d'une durée limitée dans le temps alors que celui-çi embrasse une période temporelle plus longue. Qui plus est, le temps n'est plus cette fois celui de l'individu mais un temps historique scandé le long du film à coup de référence à l'actualité d'époque de Taïwan. De ce point de vue, le film esquisse l'idée de fresque de l'histoire de Taïwan vue à travers le prisme de la cellule familiale qui fera le sel de La Cité des Douleurs. La scénario inscrit d'ailleurs dans cette perspective historique le regard nostalgique du cinéma d'Hou Hsiao Hsien. La nostalgie qu'on certains membres de la famille, c'est celle d'une Chine continentale quittée mais vers laquelle on espère toujours revenir comme si le repli insulaire sur Taïwan devait n'etre que provisoire. Et au détour d'un plan on regrette ce membre de la famille laissé sur le continent finalement détruit par la Chine communiste. Mais le changement historique n'est pas la seule chose mettant à mal la cellule familiale ici. L'ordre naturel précipitant les membres les plus âgés de la famille vers la maladie ou la mort en est un tandis qu'en parallèle les enfants grandissent et finissent par ressentir sur le tard l'importance de la cellule familiale.
Un temps pour vivre, un temps pour mourir est ainsi souvent baigné (le score aidant d'ailleurs) d'une certaine mélancolie contrastant avec l'insouciance de surface des deux Hou Hsiao Hsien précédents. Pour le reste, le style du cinéaste (cadrages distants à l'opposé de toute joliesse, sens de la durée) est désormais bien plus assuré malgré quelques longueurs dans le montage. Ce faisant l'émotion peut parfois s'offrir de façon brute, parfois jusqu'au malaise comme dans la scène de la découverte de la mort du mère qui atteint une forme de violence brute obsédante. Au fur et à mesure que le film avance, on retrouve les petites frappes, les moments anodins pleins de densité humaine et fondateurs pour un jeune individu ayant fait la force de ses films précédents. Le score fait quant à lui parfois office de liant entre certaines scènes du film en soulignant leur proximité de tonalité. Au prix de quelques passages peu inspirés, le film finit par offrir une palette émotionnelle encore plus étendue que les précédents.
On peut certes préférer ces deux-là pour leur plus grande spontanéité et parce qu'ils sont plus souvent visités par la grace. Mais Un temps pour vivre, un temps pour mourir témoigne de la progression artistique rapide du cinéaste et vaut plus que le détour pour cette raison.
Une autobiographie lucide
 Pour son troisième film, HHH nous plonge au cœur de son enfance et de son adolescence, et nous montre comment il s’est construit au contact de la vie, mais aussi de la mort. La naïveté de ses 10 ans, l’insouciance et les émois amoureux de son adolescence, la prise de conscience des responsabilités qui lui incombaient en tant que jeune adulte, toutes ces périodes de sa vie se sont brutalement retrouvées confrontées à la mort d’un membre de sa famille. Ces évènements douloureux ont à chaque fois provoqué chez lui une remise en cause de son comportement, que ce soit les « 400 coups » de ses 8 ans, les bagarres en bande de ses 15 ans ou l’amour porté aux siens en étant jeune adulte alors qu’on ne songe qu’à construire sa propre vie. Le regard accusateur du médecin à la fin en dit beaucoup sur le propos de HHH dans ce film : avec du recul, on s’aperçoit que sa famille est très importante et qu’on aurait dû en profiter plus lorsque celle-ci était vivante.
Pour son troisième film, HHH nous plonge au cœur de son enfance et de son adolescence, et nous montre comment il s’est construit au contact de la vie, mais aussi de la mort. La naïveté de ses 10 ans, l’insouciance et les émois amoureux de son adolescence, la prise de conscience des responsabilités qui lui incombaient en tant que jeune adulte, toutes ces périodes de sa vie se sont brutalement retrouvées confrontées à la mort d’un membre de sa famille. Ces évènements douloureux ont à chaque fois provoqué chez lui une remise en cause de son comportement, que ce soit les « 400 coups » de ses 8 ans, les bagarres en bande de ses 15 ans ou l’amour porté aux siens en étant jeune adulte alors qu’on ne songe qu’à construire sa propre vie. Le regard accusateur du médecin à la fin en dit beaucoup sur le propos de HHH dans ce film : avec du recul, on s’aperçoit que sa famille est très importante et qu’on aurait dû en profiter plus lorsque celle-ci était vivante.
Un temps pour vivre… est long, mais pas ennuyeux pour autant. Les mélodies qui l’accompagnent et une certaine vitalité (« certaine » car HHH n’est pas McTiernam) animent ce film reposant et délicat, qui n’hésite pas à dénoncer la place des femmes dans la société taiwanaise de l’époque à travers la frustration de la sœur qui ne peut faire des études par manque de soutien financier, ou la préférence généralisée des naissances masculines.
"Un temps pour vivre et un temps pour mourir" marque le retour d'Hou Hsiao-hsien à la campagne après son précédent film ("Les Garçons de Fengkuei") majoritairement urbain.
Il y décrit la vie quotidienne (autobiographique) à travers le personnage principal d'Ah-ha" enfant durant la première heure puis adolescent sur la seconde.
Encore davantage affirmé dans ses choix de cadres et sa mise en scène, HHH concrétise un beau film dans le sens où il montre, sans fard et de façon poignante la mort, les moments d'innocence et autres incartades juvénile ainsi que la violence entre gangs.
Le récit est également ancré dans l'histoire "avec un H" du pays via de ponctuels instants où l'armée traverse activement une rue ou à travers la radio par exemple, mêlant la grande et les histoires du quotidien des gens "simples".
Le tout est narré de manière sensiblement dilatée d'un point de vue temporel (rythme lent, peu de mouvements de caméra, nombreux longs plans fixes, durée de plus de deux heures) mais possède un sentiment de sérénité dans l'accomplissement et l'observation de ses souvenirs en tant qu'individu et metteur en scène.
Comme l'arbre enraciné très près de la maison, semblant assister, être témoin, de tous ces évènements.
07 octobre 2020
par
A-b-a
À fleur de peau
Prolongement tout à fait logique de la veine autobiographique de Hou Hsiao Hsien lancée par
Un été chez grand-père,
Un temps pour vivre et un temps pour mourir capte, dans le Taïwan instable des années 50 et 60, le quotidien d'une famille modeste au sein de laquelle nous sont relatées les phases d'enfance et d'adolescence d'un garçon un peu vaurien. À l'instar de ses deux précédentes œuvres, le cinéaste maîtrise parfaitement le cadre de son film et cet enchaînement de petites scènes de la vie ordinaire construites, illustrées et jouées avec tant de sincérité, tant de pureté, qu'elles nous touchent droit au cœur. On retrouve sur le plan formel la grammaire immuable du réalisateur: mise en scène statique et discrète, photo mate et éclairage minimaliste. Une esthétique assez radicale que vient adoucir la très belle musique de T'Chou T'Chou, à quelques encablures de certaines partitions composées par Joe Hisaichi. Mais où
Un temps pour vivre et un temps pour mourir tranche avec ses aînés, c'est dans la venue d'un certain nombre de situations plus graves, plus dramatiques, dont le caractère particulièrement cru (la mort du père, la maladie de la mère, la découverte du corps de la grand-mère à l'issue du récit) pourra dérouter. Nul doute pourtant que HHH sache tirer parti de ces ruptures de ton puisqu'elles ne trahissent à aucun moment l'uniformité réaliste d'un métrage délesté de tout pathos. Cette facture proche du naturalisme, juxtaposée à une distance sensible – qu'elle se situe au niveau de la mise en scène comme à celui de la psychologie des personnages –, aura définitivement fait la force du cinéma de Hou dans les années 80. Avec le recul, le film possède peut-être moins de fraîcheur, moins de vitalité que
Les Garçons de Fengkuei et plus indirectement
Un été chez grand-père mais il annonce déjà, en contrepartie, l'ambiance mélancolique d'un
City of Sadness, faute d'en atteindre encore la richesse narrative.
Entre vie et mort
Troisième – et avant-dernier – film largement autobiographique du réalisateur.
En voulant imiter ses grands "aînés" du cinéma taïwanais (dont Edward Yang), Hou touche déjà à son meilleur avec ces magnifiques souvenirs enrobés en un style, qui lui est bien propre. Longs plans fixes au sein d'un environnement parfaitement reconstitués (Taiwan ne semble avoir bougé depuis son enfance), où la lenteur traduit sa propre médiation sur sa vie et celle en général.
Des plus grands, il repique également une "grammaire" cinématographique, où rien n'est laissé au hasard et où le reflet de la mère dans le cadre du défunt père annonce sa propre maladie mortelle.
Un rythme très, très lent, auquel il faut se laisser aller pour pouvoir pleinement s'immerger dans l'univers particulier du réalisateur – mais d'une pureté et sincérité rarement atteints, ni dans le cinéma, ni dans par la suite de la propre carrière du cinéaste.
émotionnellement fort, mais trop long quand même.
Je n'ai pas trop aimé ce film, je l'ai trouvé assez long et mou. ( en tout cas, merci à MK2 qui m'a permis de le voir au ciné, même si la copie n'était pas de très bonne qualité )
En fait, ce que je n'ai pas aimé : c'est l'histoire d'une famille dont la vie est banale et donc, il ne se passe pas grand-chose, et ce, pendant plus de 2H...
Sinon, là c'est plus personnel, j'ai trouvé le film déprimant, à un certain moment du film, il s'en est fallu de peu que je lâche une larme...
C'est sûr que c'est bien réalisé et que, émotionnellement, le réalisateur frappe fort, mais j'ai trouvé ça trop long quand même.
Une fresque de l'intime 
Pour la première fois dans son œuvre, Hou Hsiao hsien se confronte à l'idée du Temps : thème bien sûr déjà présent dans ses précédents films, mais qui atteint ici un des ses aboutissements stylistiques. De fait, Hou est encore dans sa "phase autobiographique" et s'intéresse toujours à l'histoire d'une famille, mais il la place dans un double rapport, à l'espace et au temps.
Le rapport à l'espace, c'est la situation complexe de ces exilés qui croient que leur séjour à Taïwan ne sera que provisoire et qu'il leur sera possible de rentrer en terre natale, en Chine. La grand mère ne rêve que d'une choe, c'est de traverser le Mekong, et s'en va sans cesse par monts et par vaux, parfois accompagnée du protagoniste, mais toujours revenant en taxi. Le lieu de l'histoire est placé sous le signe du provisoire : meubles en bambous (car les parents croient qu'ils pourront partir), mais la caméra nous fait bien comprendre qu'elle est de l'ordre du permanent : plans fixes et semblables qui donnent une impression de lieux familiers. Le hors champ a encore un rôle assez restreint par rapport aux dernières œuvres du maître, mais ce hors champ est pourtant toujours évident et mentionné : c'est justement la Chine, le continent, vers lequel se dirige la Grand mère et que jamais elle ne verra.
Mais se rapport à l'espace se double d'un rapport au temps : temps de deux générations, l'une qui meurt progressivement (la grand mère est la dernière à s'éteindre), l'autre qui apprend à vivre. Il n'y a aucun manichéisme : à la fin, les jeunes comprennent que la grand mère jusque là agonisante est en fait morte par les traces de décomposition : ils ont voulu la laisser vivre jusqu'au bout et ne l'ont jamais abandonnée. De même, lors de l'agonie de la mère, Ah ha, le protagoniste, est appelé par ses camaredes de bande pour participer à une vengeance : il refuse de venir avec eux mais leur fourni cependant l'arme blanche : un rapport à la violence et à la mort assz complexe, qui montre bien la difficulté de cet apprentissage à la vie.
Aussi, si le rapport entre la ville et la campagne qui était la thématique centrale de ses précédents films est toujours aussi présente (notamment par le motif récurrent chez Hou Hsiao hsien des fils électriques, symbole du progrès mais aussi d'une autre relation à l'espace), c'est une nouvelle perspective stylistique qui s'ouvre ici, et qui aboutira aux fresques historiques, après la parenthèse intéressante de La Fille du Nil.
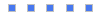

 Un peu moins abouti que ses deux précédents films, Un temps pour vivre, un temps pour mourir est néanmoins une étape capitale dans la grande oeuvre naissante d'Hou Hsiao Hsien. L'élargissement de perspective est en effet ici double. Les deux précédents Hou Hsiao Hsien évoquaient des évènements d'une durée limitée dans le temps alors que celui-çi embrasse une période temporelle plus longue. Qui plus est, le temps n'est plus cette fois celui de l'individu mais un temps historique scandé le long du film à coup de référence à l'actualité d'époque de Taïwan. De ce point de vue, le film esquisse l'idée de fresque de l'histoire de Taïwan vue à travers le prisme de la cellule familiale qui fera le sel de La Cité des Douleurs. La scénario inscrit d'ailleurs dans cette perspective historique le regard nostalgique du cinéma d'Hou Hsiao Hsien. La nostalgie qu'on certains membres de la famille, c'est celle d'une Chine continentale quittée mais vers laquelle on espère toujours revenir comme si le repli insulaire sur Taïwan devait n'etre que provisoire. Et au détour d'un plan on regrette ce membre de la famille laissé sur le continent finalement détruit par la Chine communiste. Mais le changement historique n'est pas la seule chose mettant à mal la cellule familiale ici. L'ordre naturel précipitant les membres les plus âgés de la famille vers la maladie ou la mort en est un tandis qu'en parallèle les enfants grandissent et finissent par ressentir sur le tard l'importance de la cellule familiale.
Un peu moins abouti que ses deux précédents films, Un temps pour vivre, un temps pour mourir est néanmoins une étape capitale dans la grande oeuvre naissante d'Hou Hsiao Hsien. L'élargissement de perspective est en effet ici double. Les deux précédents Hou Hsiao Hsien évoquaient des évènements d'une durée limitée dans le temps alors que celui-çi embrasse une période temporelle plus longue. Qui plus est, le temps n'est plus cette fois celui de l'individu mais un temps historique scandé le long du film à coup de référence à l'actualité d'époque de Taïwan. De ce point de vue, le film esquisse l'idée de fresque de l'histoire de Taïwan vue à travers le prisme de la cellule familiale qui fera le sel de La Cité des Douleurs. La scénario inscrit d'ailleurs dans cette perspective historique le regard nostalgique du cinéma d'Hou Hsiao Hsien. La nostalgie qu'on certains membres de la famille, c'est celle d'une Chine continentale quittée mais vers laquelle on espère toujours revenir comme si le repli insulaire sur Taïwan devait n'etre que provisoire. Et au détour d'un plan on regrette ce membre de la famille laissé sur le continent finalement détruit par la Chine communiste. Mais le changement historique n'est pas la seule chose mettant à mal la cellule familiale ici. L'ordre naturel précipitant les membres les plus âgés de la famille vers la maladie ou la mort en est un tandis qu'en parallèle les enfants grandissent et finissent par ressentir sur le tard l'importance de la cellule familiale.  Pour son troisième film, HHH nous plonge au cœur de son enfance et de son adolescence, et nous montre comment il s’est construit au contact de la vie, mais aussi de la mort. La naïveté de ses 10 ans, l’insouciance et les émois amoureux de son adolescence, la prise de conscience des responsabilités qui lui incombaient en tant que jeune adulte, toutes ces périodes de sa vie se sont brutalement retrouvées confrontées à la mort d’un membre de sa famille. Ces évènements douloureux ont à chaque fois provoqué chez lui une remise en cause de son comportement, que ce soit les « 400 coups » de ses 8 ans, les bagarres en bande de ses 15 ans ou l’amour porté aux siens en étant jeune adulte alors qu’on ne songe qu’à construire sa propre vie. Le regard accusateur du médecin à la fin en dit beaucoup sur le propos de HHH dans ce film : avec du recul, on s’aperçoit que sa famille est très importante et qu’on aurait dû en profiter plus lorsque celle-ci était vivante.
Pour son troisième film, HHH nous plonge au cœur de son enfance et de son adolescence, et nous montre comment il s’est construit au contact de la vie, mais aussi de la mort. La naïveté de ses 10 ans, l’insouciance et les émois amoureux de son adolescence, la prise de conscience des responsabilités qui lui incombaient en tant que jeune adulte, toutes ces périodes de sa vie se sont brutalement retrouvées confrontées à la mort d’un membre de sa famille. Ces évènements douloureux ont à chaque fois provoqué chez lui une remise en cause de son comportement, que ce soit les « 400 coups » de ses 8 ans, les bagarres en bande de ses 15 ans ou l’amour porté aux siens en étant jeune adulte alors qu’on ne songe qu’à construire sa propre vie. Le regard accusateur du médecin à la fin en dit beaucoup sur le propos de HHH dans ce film : avec du recul, on s’aperçoit que sa famille est très importante et qu’on aurait dû en profiter plus lorsque celle-ci était vivante.