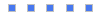

Des qualités, Jigoku de Nakagawa n'en manque pas. Bien sûr, vu l'âge de cette bobine horrifique et avec un certain recul il semblerait que le film n'ait plus ce pouvoir horrifique qui fit sa force voilà des années, on trouve pourtant de quoi faire niveau audaces formelles et prises de risques narratives. On suit effectivement la longue descente aux enfers de Shiro, jeune étudiant bien propre sur lui dont la vie va prendre une toute autre tournure après que son ami Tamura ait percuté un yakuza ivre sur la route. Et c'est là que la définition de "descente aux enfers" va prendre tout son sens et devenir imagée avec le talent de plasticien que l'on connaît de Nakagawa : tout est bon pour faire passer ses idées à l'écran et le résultat est globalement intéressant malgré une première heure creuse et qui loupe le coche rayon émotion : discussions d'une belle platitude, affaires mal avancées question mariage, vengeance des femmes mûres, jalousie excessive d'un Tamura qui fait office de diable vivant et vague partie policière passée à la va-vite via des articles de journaux de presse. Le film prend son envol lors de cette magnifique séquence sur un pont suspendu où Shiro est convoqué par une femme attirante et fatale qui se révèle être elle aussi un démon, désireuse de venger le yakuza écrasé sur la route : l'utilisation du rouge, classique du cinéma d'épouvante, souligne le portrait dangereux de la femme, une constante mais qui trouve ici une once d'intérêt. Quelle va être son attitude face à Shiro? Le faire tomber du pont après un baiser, le poignarder, lui tirer dessus? Manque de bol, et là encore les limites du cinéaste question moyen et finesse d'écriture, la dame trébuchera du pont après avoir coincé le bout de sa chaussure dans une fente, l'idiote. Et magie, Tamura apparaît et lui aussi tombera du pont. Visiblement, le cinéaste n'a pas le recul suffisant pour rendre son oeuvre un tant soit peu crédible aux yeux du spectateur, il ne s'embarrasse de quelconque procédé pour aller droit au but : faire disparaître l'entourage de Shiro un par un, c'est ce qui était prévu sur le papier et c'est ce qui va se réaliser, en dépit de toute crédibilité.


Divisé en deux parties distinctes, à la durée inégale, Jigoku emmène son spectateur là où il désire, c'est à dire dans les limbes de l'au-delà, et au film de montrer son véritable visage : celui d'exacerber l'aliénation, le déséquilibre, l'absurdité par l'intermédiaire d'une mise en scène qui se veut énergique et fascinante. L'utilisation d'une caméra qui se renverse, les grands angles rendant les visages farfelus, la déformation pure et simple de l'écran, l'utilisation inaccoutumée des couleurs, les zooms et dézooms sur un même plan pour aviver le trouble, le cinéaste met tout en oeuvre afin de représenter l'enfer et la démence de ses hôtes. C'est aussi, selon Nakagawa, le lieu où tout le monde se dit tout, comme si sur Terre il était péché de se dire les choses en face, alors que l'enfer montre le vrai visage de chacun : celui de Tamura par exemple, ou du père de Shiru. Et c'est bien cette seconde partie, en enfer, qui risque de rebuter le spectateur guère averti. Parfois insupportable car insensé, le film plonge dans la folie en espace de quelques minutes et le cinéaste démontre qu'il fait bien mieux que ce que l'imposteur Ishii Teruo fera par la suite rayon épouvante. La séquence de la roue est un supplice niveau émotions, les punitions sont gores, et si le film peut paraître aujourd'hui ringard, l'impact de ces scènes à l'époque fut important, à l'heure où le cinéma gore américain n'était même pas encore né. De plus, la représentation de l'au-delà évoque avec vingt ans d'avance et trois fois plus d'idées la scène finale de L'Au-delà de Lucio Fulci, considérée pourtant comme l'une des plus belles représentations faite à ce jour. Fort de solutions visuelles intéressantes et d'une photographie privilégiant le noir, Jigoku est une réussite du film d'épouvante japonais.

Cela avait tout pour être une des plus belles nuits de la vie de Shiro. Il venait enfin de se voir accorder la main de Yukiko, la femme qu’il aime et la fille d’un professeur respecté. Malheureusement il fallut qu’il y ait cet accident… En renversant accidentellement un yakuza ivre alors qu’il rentre chez lui Shiro est pris dans une terrible spirale de la mort qui viendra à bout de tous ses proches avant qu’il ne soit lui-même emporté par l’élan de la faucheuse. Arrivé aux enfers où mille châtiments l’attendent, il lui faut à présent faire face à ses péchés…
Jigoku est considéré par beaucoup comme LE chef d’œuvre du cinéma horrifique Japonais des années 1950/60 et bien sûr de son réalisateur, le génial Nakagawa Nobuo.
Ce dernier créé avec Jigoku une œuvre certes imparfaite, mais surtout d’une grande inventivité plastique (principalement dans la seconde partie qui se déroule aux enfers, tournée on ne sait trop comment en studio). Pour représenter sa vision des huit enfers bouddhistes, il battit un univers psychotronique, haut en couleurs et terrifiant, qui lui permet de mettre en valeur son goût pour la provocation (d’un point de vue technique d’abord avec l’usage d’angles farfelus, de cadres renversés et de déformation d’images dont le film regorge, mais aussi par l’aspect sanglant ou déviant, très prononcé pour l’époque, de certaines scènes, tout particulièrement lors des tortures endurées par les damnés), et une réflexion intéressante autour du déterminisme (marquée par l’insistance sur des signes forts tels que des roues, symboles du destin, ou les rebondissements scénaristiques syncopés qui se construisent autour de forts coups du sort). On retrouve dans le film la misanthropie de Nakagawa qui s’échine à mettre en scène tous les travers de l’âme humaine : de l’homme qui trompe sa femme agonisante à celui qui empoisonne toute une assemblée pour avoir voulu faire des économies sur la nourriture, le tableau est fort peu reluisant… Et si ses précédents longs-métrages en attestaient déjà (particulièrement le très bon Yotsuya Kaidan), Jigoku confirme à quel point Nakagawa était en avance sur son temps au niveau de la réalisation de films d’horreur : outre le décorum inoubliable des enfers, on ne peut que relever une excellente maîtrise du hors-champ et un talent indéniable pour insinuer une ambiance glauque et sombre, propice aux frissons du spectateur;
Mais Jigoku n’est pas non plus dénué d’imperfections et il compte tout de même un certain nombre de défauts, plus ou moins gênants. Ainsi, il est difficile de ne pas être irrité par le goût prononcé de Nakagawa pour l’ostentation dans la direction d’acteurs, l’emploi du zoom et l’usage d’un montage sec. Les tics du réalisateur dans ce dernier domaine sont d’ailleurs particulièrement agaçants durant la première partie du film puisqu’ils nuisent grandement à l’intensité dramatique de la plupart des scènes. Et la regrettable discrétion/quasi-absence du score n’arrange pas les choses Ce n’est qu’une fois arrivé aux enfers (dans la seconde partie, donc) que le spectateur peut s’impliquer un tant soit peu émotionnellement dans l’intrigue qui à ce moment du film n’en est malheureusement plus une puisque dès lors, on n’assiste plus qu’à une succession de supplices auquel les damnés sont soumis sans répit. Enfin il faut aussi noter que malgré ses nombreuses qualités visuelles encore fortement appréciables jusqu’à aujourd’hui, certains effets du films ont très mal vieillis, notamment quand certains personnages sont précipités dans le vide.
Ceci dit, le film garde plus de quarante ans après sa sortie une saveur bien rare chez les films horrifiques de son temps dont l’intérêt semble, trop souvent, s’amenuiser au fil des années et de l’évolution des techniques. Le decorum dantesque des enfers de Jigoku reste une réussite unique dans le genre et n’a rien à envier à de nombreuses représentations récentes qui bénéficient de tout autres moyens… Cela atteste une fois de plus du talent visionnaire de Nakagawa Nobuo qui malgré quelques procédés post-datés, gagne à être connu.