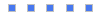

| Xavier Chanoine | 3.5 | Portrait touchant d'un artiste raté |
| Ordell Robbie | 3.5 | Première moitié plus que poussive, seconde retrouvant la verve des grands jours. |
Bande annonce
Achilles et la tortue fut présenté en compétition officielle à la 65ème Mostra de Venise, le festival italien semble être le dernier à croire au cinéaste qu’il récompensa d’un Lion d’or en 1997 pour Hana bi qu’on ne présente plus. Depuis les années 2000, toujours pas de feux d’artifices au programme malgré une perle, un succès critique et festivalier remarquable et deux films sortis d’une planète qu’on ne connait pas tout à fait encore, ou que l’on pensait connaître. La planète Kitano, Beat seul sait où et comment y aller, quitte à laisser le spectateur sur la touche et se mettre à dos les fans qui attendent encore aujourd’hui le retour de l’homme aux lunettes rondes teintées. Un peu comme cette armée de cinéphiles qui veulent un Park Chan-Wook cynique plutôt que responsable d’asile. L’image de yakuza n’échappe donc pas à Kitano, rien de plus légitime quand on sait qu’elle a participé à créer son mythe à travers le monde et à le confirmer en tant que cinéaste important à une époque où le cinéma japonais était alors en crise. Il est également possible d’évoquer les limites de Kitano auteur, lui qui provient de shows télévisés décalés sous le nom de Beat et dont cette facette –moins connue en Occident- se ressent depuis Takeshis’ comme pour combler un manque de quelque chose. Mais quelle(s) chose(s) ? L’humour Beat était justifié dans un film comme Getting Any ? puisque le film se revendiquait comédie grasse à part entière, mais pour les deux derniers ? Les thèses de la planète cinéphile pourraient faire avancer la recherche pour trouver des réponses au mystère, elles seraient sans doute loin du compte. Achilles et la tortue semble être le dernier volet d’une série de trois films consacrés à la remise en question du statut d’artiste –mais aussi de cinéaste : peut-on après coup trouver des réponses quant au virement artistique soudain opéré avec Takeshis’ puis, de moindre mesure, Glory to the Filmmaker ? Pas sûr tant le film n’a pas grand-chose à voir avec les précédents. Si l’on est toujours en face d’un artiste raté, celui-ci n’en n'est pas vraiment conscient (alors que le cinéaste de Glory to the Filmmaker le savait pertinemment et tentait d’y trouver un remède avec sérieux) malgré les échecs et les refus qu’il essuiera face aux acheteurs potentiels. Mais contrairement au cinéaste du précédent film, Machisu fait davantage figure de personnage simplet, peu réactif et éduqué, qui écoute tout ce qu’on lui dit sans faire preuve de jugeote. Quand un acheteur lui conseille des bouquins de grands artistes peintres, ce dernier ne fera que du copycat sans âme pour un résultat impersonnel et pire encore, très en-dessous du modèle de base. Mais tout ceci interviendra au cours des premiers pas de Machisu peintre revendiqué après être passé par l’école d’Arts.


Au cours de son enfance, Machisu a vécu dans une famille aisée. Son père, homme d’affaires dans l’industrie de la soie, achetait avec l’avis de son conseiller roublard tout ce qu’on lui disait être de l’art, alors que les tableaux revêtaient de la plus grossière des supercheries. Face aux nombreux tableaux simplets recouvrant les murs de sa maison, Machisu se prit de passion pour la peinture et s’inspira de ces modèles. Mais tout ce beau monde s’écroula lorsque son père se suicida suite à la banqueroute de son entreprise, laissant sa femme et son enfant seuls face aux difficultés qu’ils allaient bientôt rencontrer. Machisu se retrouve livré chez son oncle fauché parce que sa mère n’a pas d’autres solutions. Kitano veut d’ailleurs que Machisu soit différent, hors-normes, dès son enfance. Il est un des rares à dessiner tous les bus et toutes les poules qu’il trouve sur son chemin, porte un short en plein hiver et est reconnaissable par le béret qu’un artiste peintre lui donna voilà quelques temps déjà. Ce béret français, il ne le lâchera pas de toute sa vie, tout comme ce caractère imperturbable lui conférant un charisme proche de celui d’une vache obèse prête à mettre bas. Et son enfance, il la passera à prendre des beignes par son oncle (Osugi Ren), à tenter des expérimentations avec la peinture jusqu’à peindre des immenses poules à même le sol avec son ami demeuré. Des demeurés, il en croisera également au cours de son adolescence, notamment dans l’école qu’il fréquente avec ses amis performeurs (incroyable séquence underground où ces derniers jouent avec leur corps quitte à mettre leur vie en danger) avec qui il tentera des expériences de tout poil, comme foncer à vélo droit dans un mur en portant des sceaux de peinture près à éclabousser une toile. Une éclaboussure de folie dévastatrice. Le film laissera d’ailleurs à ce moment un peu de côté son aspect purement biographique pour laisser exploser le style unique de Kitano Takeshi, entre gros moments de silence, calme plat et hystérie festive étudiante où l’on pose pour une photo comme les surfeurs le faisaient également dans le sensible A Scene at the Sea. Instants mémorables au très fort pouvoir nostalgique, les photos rappellent les belles années créatives d’une époque où l’on jouait les punk artistes tandis que Machisu, pourtant dans le mouv’, tirait encore une tronche pas possible en voyant ses amis passer l’arme à gauche un par un. On ne parle pas de suicide artistique, mais d’acte réalisé pour contester face aux gens qui ne croient pas au pouvoir de l’art sous toutes ses formes, aux possibilités d’ouverture culturelle qu’elles entraînent.


La mort accidentelle fera également parti des essais artistiques entamés par cette belle brochette de cinglés, comme pour rappeler les premières tentatives guère concluantes des machines volantes ou des fusées spatiales. Certains ont donc payé de leur vie pour faire avancer le progrès (ou les expérimentations artistiques), à leur manière, sans recevoir d’hommages ou de louanges. Des éternels anonymes précieux. Cette formation acquise tout seul depuis son enfance, Machisu la garde précieusement au fond de lui jusqu’à ses vieux jours en tentant de créer sans cesse, de pousser l’utilisation de la peinture vers des sentiers inexplorés jusqu’à tomber dans le morbide le plus sidérant. Malgré les refus et les échecs qu’il essuie depuis toujours, la passion reste intacte et favorise l’expérimentation comme par dépit. Pousser la création en se servant d’accidents de la route, de cadavres ou d’un intérieur de maison démontre l’acharnement de l’artiste, contrastant avec son attitude avachie et son absence de mouvements. A quelques exceptions près, le Machisu vieillard est immobile, comme figé dans sa peinture, incapable d’évoluer malgré ses prises de risques visant jusqu’à égratigner sa femme, pourtant la seule à le comprendre, à coups de mandales imbibées de peintures infligées par une armoire à glace black sortie tout droit d’un show télévisé dont Beat en a le secret. Pour l’amour de l’art. Malheureusement rien n’y fait, Machisu tentera l’ultime toile face à la mort dans une séquence finale émouvante mais désamorcée deux plans plus tard par une première visite à l’hôpital hilarante. L'art du tragi-comique. Ce n’est pas nouveau chez Kitano, la mort et l’humour cohabitent comme deux bons vieux copains au sein d’un même film, faisant de son œuvre un tout unique qui aura donné lieu à de magnifiques exemples avec Sonatine, Hana bi ou encore Dolls. Sans doute aussi après avoir essuyé de nombreuses critiques et autres reproches, Kitano Takeshi s’est dit qu’il était temps de revenir à un cinéma moins égaré à la narration davantage classique, Achilles et la tortue confirme cette donne en revenant à un style plus poétique et apaisé frôlant le dramatique de par le personnage qu’incarne Kitano et son entêtement à créer dans la désespérance. Sans être un clown triste (qu’il incarna avec semi-échec/semi-réussite dans Takeshis’), le Machisu vieillard rappelle le temps d’une séquence d’isolement en voiture le Aniki de Sonatine dans son dernier acte. Cependant, cette époque est clairement révolue, l’aficionado recherchant la texture, l’émotion dramatique et la patte inimitables du Kitano des années 90 peut encore rêver de douces utopies, Achilles et la tortue est certes son véritable film apaisé et l'un de ses plus sensibles depuis Dolls, il n’en n’est pas moins que la transition confirmée de son cinéma, celui en pleine ère du numérique, de la comédie facile et peu onéreuse dans un contexte de quasi crise artistique.


Achilles et la tortue débarque comme pour crier sur tous les toits qu’il ne faut pas laisser le cinéma dans sa forme la plus artistique de côté, qu’il est encore possible de surprendre malgré la relative baisse de qualité du cinéma japonais depuis le début du 21ème siècle, hormis des auteurs parmi d’autres comme Aoyama Shinji, Sono Sion, Kawase Naomi ou le vétéran Obayashi Nobuhiko, qui, dans leurs univers propres, tentent d’apporter année après année leur pierre à l’édifice « création ». Et si cet Achilles et la tortue est un film adorable et parfois très touchant, il n’est pas exempte de défauts à commencer par des teintes oscillant entre le réussi (l’enfance de Machisu) et le terne. Les transitions, sous forme de cartons très colorés ne sont des plus convaincants non plus, bien qu'ils restent cohérents avec le minimalisme du trait de crayon de l'introduction animée. Cependant, le film dispose de cadres collant au plus près des émotions variées des personnages : de la frontalité la plus absolue d’une photo souvenir aux cadres plus aériens comme pour marquer le tourbillon des émotions et le bouillonnement d’imagination –médiocre- de l’artiste, la diversité est à l’image de l’art pictural : évidente et nécessaire. Les nombreuses ruptures de tons et les instants plus déconcertants étonnent également, le nombre dingue de peintures réalisées par Kitano himself accompagnent le film d’un doux parfum lunatique dans une atmosphère de poésie tout à fait instable propice à l’émotion, Kitano réussissant à rendre son personnage attachant dans son combat de créer encore et toujours. Ce portrait d’un homme convaincu est bien entendu convaincant malgré ses maladresses, l’art unique de Kitano transpire aussi bien dans un registre qui tient du miracle, celui de la compassion pour un artiste raté, que dans ses élans d’humour parfois caloriques, en témoigne la scène impliquant Susumu Terajima dans un caméo éclair précédé d’un molard dans des chiottes grasses d’une vulgarité inouïe. Reste que les instants plus joyeux –et surtout plus fins- ne manquent pas à l’appel, bien aidés par une partition sobre et très mélodique (Hisashienne diront les mauvaises langues) de la compositrice Kajiura Yuki, nous confirmant que personne ne souhaite la mort du Kitano artiste, dont le Machisu finira par se représenter en fin de métrage au sein d’un cadre que l’on expose lors des cérémonies funéraires au Japon. Heureusement, et fait assez rare pour être souligné chez Kitano, l’optimisme sera de rigueur.



