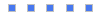
Au vu de son panorama sur le récent cinéma japonais, il faut bien reconnaitre que le festival Paris Cinéma a travaillé sur une sélection de films particulièrement éclectiques, mettant l’accent sur les genres et les saveurs pour un résultat surprenant. En exposant les différentes facettes du cinéma japonais de ces dernières années, la sélection aura démontré combien cette cinématographie compte aujourd’hui.
Autre film au concept original quoiqu’un brin désuet, La Grenadière de Fukada Koji, utilisant le « ganime » comme procédé visuel. Pour faire plus simple, le film est une succession de toiles à la manière de La Jetée de Chris Marker, accompagnées par la voix off des narrateurs/protagonistes des toiles de Fukazawa Takeshi. Le récit, inspiré de La Grenadière de Balzac, revient sur une mère et ses deux enfants, récemment installés dans la ville de Tours. Œuvre tourmentée et visuellement remarquable, elle souffre en revanche de son propre procédé qui tend très vite à l’austère. Un procédé qui ne va jamais au-delà de la succession d’images fixes (avec certains jeux sur la lumière) et dont l’absence de vie se ressent trop souvent. On reste dans le schéma de la toile et du commentaire par-dessus. Et malgré les différentes nuances d’interprétation lorsque les voix off récitent Balzac, il est difficile de ne pas décrocher.
Dans un tout autre genre, Human Comedy in Tokyo du même cinéaste n’est pas fondamentalement si éloigné que La Grenadière. On retrouve cette espèce d’atmosphère anxieuse et peu assurée, hésitante. Trois segments pour un film dépassant allègrement le deux heures, ce cousin asiatique d’Hong Sang-Soo n’a pas sa drôlerie et lorsqu’inspiré, sa poésie, mais fait preuve d’un caractère parfois surprenant. C’est justement dans ses moments les plus inattendus que le film réussit à convaincre malgré sa raideur. Le premier segment met en scène la rencontre au théâtre de deux femmes qui ne se connaissent pas et qui vont se lier d’amitié au fil du temps, le segment revient quant à lui sur la mise en place d’une exposition de photos d’une jeune femme et le troisième suit la renaissance d’un type devenu manchot après s’être fait écrasé par une voiture. Bien que peu liés entre eux (le titre du nouveau segment apparaissant uniquement à l’écran), les épisodes conservent certains personnages, mais de là à parler de carrefour de rencontres à la Hong Sang-Soo, il y a encore du travail. Pas souvent drôle ni inspiré dans sa mise en scène réduite au plus stricte minimum, Human Comedy in Tokyo a néanmoins donné l’occasion à la troupe de théâtre Seinendan de s’exercer au cinéma, domaine bien différent des planches selon l’une des actrices du film présente à Paris. Néanmoins, les épisodes semblent manquer de véritables péripéties. Bien qu’attachant lorsque nocturne, le premier opus expose l’amitié dans sa plus simple forme entre deux femmes, toutes deux bien décidées à retrouver la trace d’un danseur, mais leur aventure manque singulièrement de piquant. Le second opus semble tourner en rond jusqu’à la fête ratée au sein de la galerie d’art tandis que le dernier semble se perdre entre absurdité (l’utilisation du bras amputé) et expériences scientifiques. Et cette comédie humaine d’être finalement structurée autour des relations hommes/femmes trop soporifiques pour convaincre un minimum.
Quelques mots du cinéaste « Ce film est inspiré des œuvres de Balzac, mais j’ai tout du moins adapté sa méthode. J’ai découvert ses œuvres avec Les 400 coups de Truffaut. Pour l’anecdote, Eric Rhomer disait que l’on devait bien lire les œuvres de Balzac si l’on voulait devenir cinéaste. Ce qui m’attire chez ce cinéaste, c’est que les dialogues entre les personnages ne sont pas uniquement là pour faire fonctionner le récit, ils sont un pur motif. J’ai donc voulu reproduire ce même effet avec ce film. »


Se voulant aussi être absurde, To Walk Beside You du jeune cinéaste Ishii Yuya passe quant à lui la vitesse supérieure et n’hésite pratiquement jamais sur ses thèmes abordés : comédie sociale en mouvement perpétuel, portrait de la jeunesse sous pression (sois avocat ou médecin, mon fils !), autopsie de la fuite idéale, fable sur le mensonge et fausse comédie optimiste sur les recréations de liens (les fausses retrouvailles finales entre la professeur et son supposé fils) dont l'ombre du suicide semble planer tout du long, le film manipule le spectateur et brille par l’interprétation convaincante de ses personnages, habités par une espèce de maladresse contagieuse. Par son comique de répétition, son goût prononcé pour sa violence décomplexée pouvant surgir au moment où on ne l’attend pas, To Walk Beside You emporte l’adhésion malgré une photographie manquant d’ambitions, pas bien aidée par une projection en vidéo bien verdâtre comme il faut.
Heureusement, son dernier film Sawako Decides bénéficiait, lui, d’une projection 35mm. Considéré comme une œuvre moins personnelle, celle-ci n’en est pas moins réussie. Portrait d’une jeune femme convaincue d’une vie faite d’échecs, le film suit les mésaventures de Sawako, qui ne trouve pas d’autres solutions que d’avaler des litrons de bière pour se dire que, finalement, « elle n’y peut rien ». Comme un disque qui tourne en boucle, cette petite phrase lourde de sens résume bien la vie de la jeune femme, pas sûr d’être amoureuse de son petit ami, écolo dans l’absolu, un brin ringard. Sawako et la petite fille de son homme décident de quitter Tokyo pour sa ville natale afin de reprendre l’industrie de mise en barquettes de palourdes tenue par son père. Là-bas, les souvenirs vont ressurgir et la réputation de la jeune femme peu flatteuse va lui causer quelques soucis : fugue durant son adolescence vue d’un mauvais œil, premiers amours avec un professeur de tennis toujours pas digéré par une de ses anciennes amies, et toujours ce manque d’ambitions symbolique d’une crise économique épuisante. Sawako Decides dégage de sa mollesse quelques remarquables scènes d’humour, tout comme lorsqu’il s’anime pour finalement retomber de plus bas. Ainsi, les chansons pour motiver les travailleuses de l’entreprise de palourdes sont hilarantes parce que personne ne croit à la motivation qu’elle est censée insuffler au groupe. Le film est comme un coup perdu d’avance, une incroyable erreur de casting, mais « on n’y peut rien ». Beau film sur le couple imparfait et sur la relation père/fille, liqueur douce-amère qui défonce par la même occasion ces satanées valeurs ancestrales et on-dits qui minent le moral. Correctement mis en scène sans en faire des tonnes, Sawako Decides confirme sans trop de problèmes Ishii Yuya comme un petit maître de la comédie amère, qui laisse entrevoir quelques signes d’une probable relève d’un Itami Juzo lors des retrouvailles entre Sawako et son homme en fin de métrage. On croise les doigts.
Quelques mots du cinéaste : « Sawako Decides a été réalisé dans le cadre d’une sortie commerciale, alors que To Walk Beside You a été tourné de manière plus indépendante, loin des systèmes de grande production. »
Avec une thématique fortement ancrée sur les dérives sentimentales du Japon contemporain, Sweet Little Lies (sélectionné en compétition officielle) explorait quant à lui l’absurde incommunicabilité d’un couple tout ce qu’il y a de plus normal. Ruriko (Nakatani Miki) et Satoshi (Omori Nao) vivent ensemble mais ne partagent rien. Le mari reste cloîtré dans sa chambre pour jouer à ses jeux vidéo tandis que Ruriko accepte le bonheur de son mari. Le plus drôle dans tout cela, c’est cette incapacité du couple à faire des choses comme un vrai couple : ils ne savent pas se prendre dans les bras, n’ont pas fait l’amour depuis deux ans, mais rien qui ne semble nuire à leur quotidien. Jusqu’à ce que Ruriko fasse la rencontre d’un fan amoureux et Satoshi d’une jeune femme admiratrice du bonhomme. Le couple va alors vivre ses premiers émois extraconjugaux, ses petits mensonges aussi doux qu’une caresse. Réalisé par Yazaki Hitoshi (remarqué pour son Strawberry Shortcakes de fort belle tenue) et adapté du roman de Ekuni Kaori, cette vision du couple en apparence sans amour convainc par son aspect desséché et désenchanté. Tout en douceur, le filmage bascule néanmoins dans une série de tics agaçants : Nakatani Miki a beau avoir un extraordinaire regard, elle est souvent à la limite de la pose. Secondo, les barrières invisibles qui empêchent le couple d’évoluer normalement sont parfois si grosses qu’elles rendent certaines séquences peu crédibles. On n’a qu’une envie, que cet idiot de mari se prenne en main et fasse voltiger Ruriko dans tous les sens pendant une nuit torride. Impossible, le cinéaste préfère souligner la fausseté de leur couple, ironisant les éternels tadaima/okaeri, la mise en scène tout en retenue empêche heureusement le film de tomber dans la caricature. Malheureusement le film se traine dans un épilogue ennuyeux avec une symbolique de l’ours en peluche gentiment neuneu. Je te perds, je te retrouve, va-t-on repartir sur de bonnes bases ? C’est tout ce qu’on leur souhaite, mais au bout de deux heures le combat n’est toujours pas gagné. Un peu vain.


En retournant sept ans en arrière, le déjà très expérimenté Hiroki Ryuichi offrait avec Vibrator son beau road-movie sentimental. Là, tout de suite, « sentimental » fait niais. Oublions cette idée-là, les enfants de cœur ne sont pas admis à l’entrée. Caméra sur épaule, voix-off entêtante, écriteaux sur fond noir, baise à bord d’une cabine de camion et fierté laissée de côté. Rei (Terajima Shinobu) abandonne sa solitude pour s’offrir un voyage improvisé aux côtés d’un routier tout aussi seul. Pulsions, souvenirs et anecdotes de vie vont rythmer leur aventure, malgré l’étrange douleur intérieure dont semble souffrir la jeune femme. Avec Vibrator, on aura vu la consécration d’une grande actrice et ce, pour son deuxième film. Elle confiait d’ailleurs que le cinéaste « avait été convaincu du talent de cette dernière rien qu’en la voyant de dos. Une silhouette qui dégageait une immense tristesse ». Hiroki Ryuichi parvient quant à lui à dégager de la crasse et du malaise ambiants une certaine forme de poésie triste et décharnée. Ainsi, la détresse d’une séquence nauséeuse contraste avec le sublime d’un bain pris à deux. De plus, le cinéaste évite comme par magie de tomber dans le piège de la complaisance malgré une caméra au plus près des maux et des protagonistes littéralement mis à nu.
Parce que le cinéma japonais aime se préoccuper de sa jeunesse, Solanin du tout jeune cinéaste Miki Takahiro met en avant les problèmes créés par la crise économique de ces dernières années. L’insécurité de l’avenir de jeunes gens prometteurs, l’incertitude du lendemain et des choix de carrière. Que fera-t-on demain ? Autant de questions que se posent les blasés Meiko et Tanada, jeunes amoureux évoluant dans des domaines qui ne sont clairement pas les leurs. Démissionner risque d’être la seule solution envisageable, mais il manque une bouée de secours : peu d’ambitions pour la jeune femme tandis que le copain n’a même pas la force de se relancer avec son groupe de rock. La séparation, alors, pour redémarrer à zéro ? Dommage que le film s’enlise dans l’incertitude totale à mesure que l’avenir des jeunes adultes s’assombrit de plus en plus. Au film de perdre une partie de sa crédibilité au moment de l’accident (volontaire ou pas) du petit ami, qui, en confondant vitesse et précipitation (c'est-à-dire l’opposé de son attitude blasée), finira par laisser réellement sa vie de côté. Film destiné à un public d’adolescent, lecteur du manga éponyme de Asano Inio, l’ensemble est trop lisse et ancré dans le souvenir pour convaincre un public plus large. La culture du gambatte ne !, si prisée des ados, trouve son apogée en fin de métrage lorsque Meiko veut reprendre le groupe de rock de son petit ami pour lui rendre hommage et prouver que tous peuvent y arriver. De toute manière, on peut tout pardonner au film parce que Miyazaki Aoi est une tuerie monumentale. Lorsqu’elle est à l’écran, il est difficile de se détacher de son regard plein de malice et de mélancolie. Malheureusement, le cinéaste rappelle un peu trop à tout le monde que Miyazaki Aoi a incarné Nana, et cela risque de lui coller à la peau pendant encore quelques années.
Dès son introduction en forme d’hommage évident au cinéma d’Ozu, par ses cadrages au raz du tatami, les vas-et-viens des personnages entre les cloisons d’un intérieur labyrinthique, ce plan sur une façade d’immeuble laissant découvrir une part d’un ciel bleu radieux et cette musique guillerette, About Her Brother semble revenir à la source d’un cinéma de chronique familiale extrêmement populaire jusqu’à la fin des années 50. Et étrange coïncidence, les idiogrammes de Koharu signifient quelque chose comme « Printemps précoce » en japonais. La théière rouge, la même que celle entraperçue dans le beau Fleur d'Equinoxe, premier film en couleur d’Ozu. De même, About Her Brother a beau se concentrer sur le comportement outrageant de l’oncle Tetsuro, il n’en demeure pas moins un film où la place de la femme relève d’une grande importance. N’en disons davantage, vous aurez saisi les similitudes avec l’œuvre d’Ozu. Mais davantage qu’un film-hommage sur son copain, About Her Brother ne capte pas l’air du temps, mais se souvient. Le cinéma de Yamada n’est plus d’une grande modernité mais sa faculté à capter l’instant nostalgique d’une situation ou d’une époque force le respect. A travers de nombreux clins d’œil à la série des Tora-san dont on peut apercevoir trois extraits, il rappelle l’importance des liens solides au sein d’une famille. Se serrer les coudes pour progresser face aux déconvenues –le divorce, l’économie en berne. De plus, le personnage de l’oncle rappelle énormément Tora-san : malgré son caractère épineux, il est un personnage au grand cœur aimé de tous, bourré de défauts et très souvent maladroit, arrivant en ville et repartant de plus belle à cause d’une gaffe. En élaborant une structure narrative très connue de ceux familiers avec l’œuvre passée du cinéaste, Yamada Yoji explore avec humour et pathos –juste ce qu’il faut- une tranche de vie de gens moyens. Avec de beaux numéros d’acteurs, le film est suffisamment bien joué pour ne pas tomber dans la caricature ou le rire trop forcé. Tout n’est pas d’une grande finesse –là où Kabei paraissait mieux dosé- mais les personnages attachants permettent au film de maintenir l’attention tout du long. La séquence du mariage en ouverture brille par son dynamisme et mention spéciale à l’idée des rubans de l’une des scènes finales, donnant tout son sens aux « liens » qui unissent un frère et une sœur, que pourtant tout oppose.


Derrière ses grosses épaules un peu tristes, The Catch de Somai Shinji est également un beau film sur la puissance des rapports humains en société à travers la lutte des classes sociales. Jusqu’à ce que l’amour pour la pêche au thon dépasse celui pour les êtres humains et propulse le film au rang de tragédie. Fusajiro (Ogata Ken) en est le principal responsable, personnage dévoué aux océans, délaissant sa seule fille, Tokiko, avec qui il vit. Leur séparation n’y changera pourtant rien, Fusajiro continuera son métier, le cinéaste y exposant la terrible indifférence des émotions de son protagoniste principal qui refuse d’aller au-delà du tabou des classes sociales : en n’acceptant pas le futur mariage de sa fille avec le serveur Shunichi (le tout jeune Sato Koichi), Fusajiro se retrouve à présent seul pour affronter son quotidien mer/saké, plus déshumanisé qu’auparavant. Inversement, fasciné par le métier et le courage de Fusajiro, Shunichi fait tout en son possible pour le convaincre d’apprendre le métier à ses côtés. Le cinéaste nous embarque alors en pleine mer pour nous faire vivre les difficultés d’une pêche au gros mais garde cette incroyable faculté à filmer également le déchaînement sur terre, la séquence de poursuite entre Fusajiro et une ex sous des trombes d’eau ou la crise entre Shunichi et Tokiko en sont les meilleurs exemples. Pourvue de plans-séquences, la mise en scène de The Catch épouse finalement parfaitement son propos : elle souligne sobrement les vas-et-viens des personnages par des travelings interrompus, devient plus chaotique en mer ou bien plus terre-à-terre en intérieurs. Le spectateur peu familier à l’œuvre du cinéaste découvrira cet espèce de joyau brut pas tout à fait déchiffrable mais fascinant lorsqu’il souligne à merveille les émotions des personnages. Rien n’est ici fortuit.
Si une projection a bien laissé des traces sur la signification de sa mise en scène, c’est bien la sublime Mélodie Tzigane de Suzuki Seijun qui, pour l’occasion, offrait une approche décomplexée et parfois nonsensique de son nouveau cinéma. « Nouveau », entendons « résurrection », puisque le film suit une nouvelle étape entamée avec Histoire de mélancolie et de tristesse, dix ans après son terrible échec –et accessoirement l’un de ses meilleurs films, le tristement célèbre Marque du tueur, qui lui vaudra par ailleurs un licenciement du studio Nikkatsu. Premier film de la trilogie sur l’ère Taisho et gros succès critique/festivalier au Japon (le film fut également nominé pour l’Ours d’or à Berlin), Mélodie Tzigane fascine par ses visions surréalistes et la maîtrise de sa mise en scène. Les intérieurs brillent par leur étrangeté (des lumières s’éteignent puis se rallument, une paroi tombe pour laisser apparaître un décor de l’enfer) à l’image d’une narration éclipsant les pistes et autres marques sur lesquelles le spectateur peut se rattacher pour finalement le mener vers un monde difficilement compréhensible. Cette ère Taisho ne semble appartenir à rien de très concret, les personnages sont aussi mystérieux (Harada Yoshio) que déroutants (Fujita Toshiya en constante réflexion) voir marginaux (le trio d’aveugles), Suzuki semble exprimer un curieux langage difficilement déchiffrable que l’on se plait à vouloir déchiffrer face à cette déferlante d’images surréalistes, parfois d’une beauté à couper le souffle. Est-ce de cette ère Taisho que Suzuki se souvient ? Finalement son œuvre est restée cohérente depuis le début : savoir intriguer tout en appliquant un dispositif formel et narratif loin des sentiers battus habituels. Cette forme d’expression remarquable n’aura pas convaincu le public parisien qui se sera échappé en masse au cours de la projection, il faut dire qu’en plus d’être difficilement accessible, Mélodie Tzigane est trop long. Certains d’entre eux étaient pourtant les premiers à quémander par des braillements à voix haute ou des claquements de mains le lancement de la projection, à cause de ses quelques toutes petites minutes de retard…
Un public néanmoins venu en masse pour accueillir le dernier rejeton malade de Wakamatsu Koji, Le Soldat dieu, qui aura valu à son actrice principale, Terajima Shinobu, le prix d’interprétation féminine au dernier festival du film de Berlin. Une reconnaissance internationale amplement méritée pour cette actrice découverte dès son deuxième film, Vibrator. Elle campe ici le rôle d’une femme de soldat écœurée lorsqu’un jour la guerre sino-japonaise lui rend son mari difforme. Devenu homme-tronc sourd et muet mais personnage élevé au rang de « soldat dieu » pour son héroïsme au combat, il n’est à présent de plus aucune utilité mais se doit d’être célébré, nourri et chouchouté par sa femme qu’il battait jadis. En y montrant une affection basculant progressivement vers le dégoût, Wakamatsu expose les contradictions de la gloire rendue aux soldats qui ont servi d’une manière ou d’une autre les intérêts de l’Empire. Pourtant, ces personnages à présent intouchables et bordés de médailles ont beau être célébrés dans tout le pays, ils sont condamnés à porter les traces de la guerre. Ce soldat-ci est l’un des meilleurs exemples puisqu’il ne peut strictement plus rien faire lui-même, le vice étant poussé jusqu’à lui ôter la parole. Impossibilité de se mouvoir et de communiquer sans se tordre dans tous les sens, il est l’emblème ramollo et ridicule de l’idiotie des affrontements. Celui qui était jadis ce soi-disant brave soldat n’est plus qu’un tronc repoussant, gros bébé quémandant sa généreuse pâtée et ses mamelles à téter. Areu.


Une attitude qui exaspère rapidement sa femme, Shigeko. Pire, quand ils « font l’amour » et que son mari n’est pas satisfait –ou en demande plus, celle-ci se souvient des coups qu’elle recevait de lui, et lui, des images de viol auxquels il participait sur des paysannes chinoises. Et cet homme, sous prétexte d’une grenade adroitement lancée dans le camp ennemi, est à présent considéré comme un dieu. Il fallait bien Wakamatsu pour critiquer ce principe. Reste que si la critique est courageuse et bienvenue, le film tend à devenir rapidement répétitif : le procédé bouffe/baise/dodo, fardeau intéressant pour montrer la dégringolade frénétique du couple trouve rapidement ses limites surtout lorsque le contexte/rappel Historique est maladroitement lié au récit. Hormis l’interprétation soufflante de Terajima Shinobu et la métaphore du soldat et de la chenille plutôt bien pensée, se trouvant des airs de poésie macabre en fin de métrage, Le Soldat dieu est loin d’être marquant, relatant par exemple de manière convenue les tristes chiffres de la seconde guerre mondiale au moment des bombardements atomiques. L’approche « documentaire » du film confirme encore aujourd’hui l’importance du message politique dans les films de Wakamatsu, mais une telle banalité en guise de conclusion est décevante. A noter que la version présentée à Paris Cinéma contenait un générique final différent de celui de Berlin, une belle chanson évoquant à travers les yeux d’une enfant les terribles visions de la guerre. Au final, dommage que ses partis-pris courageux voient leur force désamorcée par une approche documentariste téléphonée.
Terajima Shinobu au sujet du film : « Cela faisait longtemps que je voulais travailler avec M. Wakamatsu. Ce n’est pas vraiment le thème du film qui m’a motivé à accepter le rôle, mais c’est plutôt l’envie de travailler avec le cinéaste. Chaque film est un nouveau défi. Pour interpréter le rôle de Shigeko, j’avais entièrement confiance en M. Wakamatsu.
Wakamatsu Koji au sujet du film : « Le film est sorti le 19 juin au Japon, mais seulement sur l’île d’Okinawa. C’est un jour commémoratif pour la troupe qui s’est suicidée après le débarquement de l’armée américaine sur l’île. J’y tenais vraiment. Il sortira également aux dates particulières du 6 et 9 août à Hiroshima et Nagasaki. Enfin, dans tout le pays 15 août, le jour de la défaite du Japon.
Les films japonais traitant de la guerre ne sont pas justes. Ils sont vraiment mensongers car aucune guerre ne peut être justifiée. Comment peut-on parler de l’amitié des soldats dans un film de guerre ? Je crois que Chaplin avait dit cette phrase : « Si l’on tue une personne, on est traité comme assassin, alors que si l’on en tue 5000, on est traité comme un héros ».
Pour sa huitième édition, le Festival Paris Cinéma a dans l’ensemble tenu toutes ses promesses. On pourrait ceci-dit trouver à redire sur la qualité de certaines projections, le format vidéo n’étant pas et ne sera jamais adapté aux salles de cinéma. Malgré tout, ce format semble être l’unique solution pour voir certains inédits, étant donné les tarifs exorbitants appliqués aux prêts de copies 35mm en provenance du Japon. L’autre point noir du festival, le trop grand nombre de films japonais uniquement projetés en version originale sous-titrée anglais, empêchant l’accès à cette cinématographie à un public non anglophone. A moins d’être familier avec la langue de Shakespeare, un film comme Tetsuo: the Bulletman, tourné en langue anglaise, ne disposait par exemple d’aucun sous-titrage français.
L’autre point noir qui fit débat, ce fut cette journée de grève du samedi 10 juillet au mk2 Bibliothèque, empêchant les spectateurs d’assister à la projection du dernier film de Yamada Yoji, ou du pinku Tandem de Sato Toshiki, entre autres. En espérant que ce blocus d’une journée ne nuise pas aux futures relations entre Paris Cinéma et le complexe du mk2 Bibliothèque.
Les quelques commentaires de Shinobu Terajima et des cinéastes ont été recueillis au cours des discussions précédant et suivant les projections. Propos de Shinobu Terajima et Wakamatsu Koji traduits par Shoko Takahashi. Tous les autres commentaires sont traduits par Terutaro Osanai.
