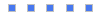Festival de Cannes 2009




AIR DOLL (KOREEDA Hirokazu)
Le réalisateur de Distance revient avec ce conte fantastique qui aurait pu être une bonne surprise si le réalisateur ne s'était pas contenté du minimum syndical. Air Doll se résume à montrer la "prise de conscience" d'une poupée gonflable sans vraiment faire décoller l'histoire. C'est certes joliment filmé mais dans le style japonais le plus classique, aucune prise de risque dans la forme, Kore Eda ne se permet aucune folie. Pourtant la première demi-heure laissait espérer un peu de déviance : Un salary man prend son repas avec sa poupée gonflable avant de la culbuter en lui chuchotant des mots doux … S'ensuit malheureusement les errances d'une poupée découvrant la "poésie de la vie" saupoudrée d'une philosophie de comptoir. Ennuyeux et finalement peu inspiré, on pardonnera cette erreur de parcours d’un auteur qui a sans doute plus de chose à nous raconter … Avec un réalisateur qui a déjà fait ses preuves on entre confiant dans la salle mais, ce film ne restera certainement dans les annales... Quelques traits d'humour brillants et une mise en scène toujours délicate qui évite habillement les rires gras que pourrait susciter cette histoire de poupée gonflable, constituent les points forts du film. En revanche, on s'ennuie véritablement dès la deuxième huere du film et, le dernier quart d'heure mérite purement et simplement d'être supprimé. Pour dénoncer le penchant de la société nippone à enfermer toujours les individus dans la solitude, le réalisateur choisit un angle d'attaque et des personnages qu'il peine à mener jusqu'au bout de son long-métrage. Il s'effondre avant la fin dans la guimauve pourtant bien absente du reste de sa narration. Un vraie déception.
ENTER THE VOID (Gaspard Noé)
Gaspard Noé remet le couvert avec un film non conventionnel dont la principale recherche est le traitement original d’un sujet. Enter the Void s’ouvre la nuit sur un quartier de Tokyo en vue subjective avec insertion d’images noires pour marquer les battements de paupières. Cette vue va connaître trois stades d’évolution suivant la progression de l’intrigue, à savoir organique pour la première étape du film, en retrait durant les flashbacks, puis désincarnée pour représenter le flottement d’une âme puisque Enter the Void traite du processus de réincarnation. Pour cette dernière, le réalisateur français reprend le concept des balancements de caméra incessants d’Irréversible et met au point une forme de mouvement continuel aérien au ras des toits de Tokyo sans raccords visibles, un peu comme la séquence de Brian de Palma dans Snake Eyes où la caméra survole une rangée de boxs. Sauf que dans le présent film, et bien qu’elle soit entrecoupée d’arrêts et de courts flashbacks, la séquence dure plus d’une heure, ce qui est proprement insupportable. A cela ajoutons une intrigue sans grand intérêt, une actrice bonne qu’à se dénuder, des essais à rallonge de rêveries stupéfiantes, des déplacements mystiques répétitifs à travers diverses sources lumineuses, quelques plans dérangeants mais totalement gratuits, et surtout un final d’un ridicule rarement égalé. Enter the Void est un film de post-production incroyablement stérile.
KINATAY (Brillante Mendoza)
Reparti du dernier festival de Cannes avec le Prix du meilleur réalisateur, Brillante Mendoza agasse autant qu’il fascine. Pas difficile lorsque, tout en faisant preuve d’une maîtrise technique remarquable, le cinéaste présente une œuvre peu ou pas du tout écrite, exempte d’une intrigue digne de ce nom et de personnages un minimum intéressants. Attributs du cinéma ici aux abonnés absents, on penserait presque au coup de bluff qui signerait son entrée dans tous les festivals, tous désireux d’avoir la perle choc tant attendue d’un pays dont on connait encore trop peu sa cinématographie. Kinatay a donc sa part d’esbroufe dans le fond, mais pourquoi lui en vouloir à partir du moment où l’on accepte d’entrer dans un univers noirissime et oppressant pour subir de plein fouet les dors et déjà fameuses séquences de la ballade en camionnette et du meurtre final, suffisamment groovy pour qu’un Tarantino adresse un mot personnel au cinéaste. Pas tout à fait vendu en tant que tel, Kinatay n’est pas qu’une simple stylisation nocturne assez démentielle, non, il est de ces objets cinématographiques captant l’atmosphère, les mouvements et les sons pour en faire un tout cinématographique. Les rues bondées de Manille, en plein jour, rappellent l’énergie paroxysmique captée dans l’attraction Slingshot, autre grand moment de fureur estampillée Six Flags faisant dans le virtuose permanent, avec en filigrane une constatation désagréable voir gênante des conditions de vie dans les quartiers les plus pauvres des Philippines. Les séquences de jour sont jusqu’ici les plus normales et énergiques, instants captés sous forme de procédés lorgnant vers le documentaire : on y cuisine, amène son gosse à la nourrice, étudie à l’école après un passage obligatoire en bus blindé de gens, peu de choses foncièrement différentes d’un documentaire tourné pour les chaînes spécialisées. C’est lorsque la nuit débarque que les choses se gâtent et prennent une tournure désespérée. Si de jour Manille ressemble à une ville grouillant de monde et d’activités, on se contentera le soir des lumières de la ville derrière les vitres crades d’une camionnette. Pas d’occasion d’aller boire un verre aux terrasses extérieures, on sortira du véhicule pour aller pisser et chercher des bouteilles. Kinatay utilise le langage cinématographique de la paroi (le véhicule, pas d’échappatoire) pour créer cette sensation d’étouffement qui sera encore plus « aboutie » lors de son dernier tiers situé dans une cave. Rien de bien nouveau, certes, mais Brillante Mendoza se sert des décors, des surfaces, pour exprimer le ressenti du personnage de Peping, notamment lorsque la caméra s’attarde sur une des vitres du véhicule reflétant toute sa détresse et son incompréhension face à ce qui se déroule sous ses yeux. Et quand on connait la milice locale, difficile d’imaginer un bleu prendre la fuite. Impuissant, le gamin (il n’a que vingt ans) assistera au kidnapping d’une prostituée endettée de 100 000 pesos et à son massacre, les yeux brillants et le souffle coupé. La grande qualité de Mendoza est de filmer ces visages troublés, paralysées par la barbarie, plutôt que de filmer l’horreur de manière frontale. On apercevra les restes de la victime, sans néanmoins s’y attarder, parce que cette violence, selon Mendoza, n’est pas à imaginer par le biais d’un hors-champ, il veut prouver qu’elle existe. On lui évitera le procès d’intention trop facile. Car si Kinatay brille par son absence de scénario et ses symboliques -la religion, notamment- un peu inutiles, le fait de passer une journée entière avec Peping n’a guère plus d’intérêt. Mendoza comble les possibles brèches par une caméra alerte, mouvementée –à l’image de ce qui se passe dans la tête du bleu-, capte la moindre matière pour s’en servir comme langage cinématographique. Il s’y dégage un suspense finement retranscrit lorsque le gamin se retrouve seul, donc dans une situation d’échappatoire, mais incapable de laisser tomber sa casquette de débutant à la solde d’un gang de découpeurs, de peur des représailles. Une contrainte s’ajoutant au lieu de massacre trop éloigné de Manille, l’empêchant de rentrer ou de trouver une aide autour de lui. Mais le plus terrifiant, au final, c’est de partager une bière et un repas en compagnie de bourreaux presque ordinaires, au cours d’un épilogue saisissant rappelant en quelque sorte l'oeuvre des bourgeois du Martyrs de Pascal Laugier. L'horreur n'a pas besoin de contes, de légendes ou d'imaginaires farfelus pour exister, elle est autour de nous.
MOTHER (Bong Joon-Ho)
Ce qui est vachement bien avec Bong Joon-Ho c’est cette régularité tranquille, ce culot monstre qui parsème l’ensemble de ses films et ce même depuis ses débuts, des thématiques diverses et variées abordées au sein d’un même film (Memories of Murder avait lancé la mode des polars coréens critiquant le système), et cette passion pour le cinéma tout court. Pour faire simple, on remplace les flics poissards de Memories of Murder par une mère, et l’on obtient des plus naturellement Mother. Le cinéma de Bong Joon-Ho, pourrait donc être aussi limpide et efficace qu’un nom commun, une mère. Il est ici question d’une mère, donc, et d’un fils, Do-Joon. Rien de bien compliqué. Mais lorsque ce dernier, un peu simplet, est suspecté de meurtre, l’affaire prend une toute autre tournure : alors qu’il terminait de se saouler au bar Manhattan, dans l’attente de pouvoir tirer son premier coup, voilà qu’une écolière en jupe traine dans les environs. Rentre-t-elle chez elle ? Essaie-t-elle de fuir quelque chose, quelqu’un ? Les réponses viendront plus tard, au fur et à mesure que le film lâche ses cartes par petites touches savamment orchestrées par un grand cinéaste. Do-Joon la suit tout naturellement, amateur de mollets blancs, il est comme attiré par cette jeune-fille. Après quelques mètres, la jeune fille disparait au détour d’une rue sombre, repousse le garçon avec une pierre (et accessoirement, un gag digne de Tex Avery), il fait marche arrière, écran noir. Le lendemain, la fille est retrouvée morte, perchée sur une rambarde au dessus d’un toit dominant l’ensemble du village. Pourquoi exposer un mort à tout le monde alors qu’une autre manière, un enterrement, aurait été plus rusé ? A côté d’elle, une balle de golf marquée du nom de Do-Joon, récupérée la veille par ce dernier et son ami après avoir réglé quelques comptes avec une famille de bourgeois qui ont manqué d’écraser le simplet et son cabot. Evident ou non, il est donc immédiatement arrêté par la police, sous les yeux effarés de sa mère, alors bien décidée à prouver son innocence par tous les moyens, jusqu’à aller soupçonner le meilleur ami de Do-Joon. Le ton est donné dès la découverte du corps : les flics n’en ont rien à faire, perdent du temps, se posent des questions comme l’inspecteur Derrick, une référence en la matière. Je déconne. Résultat, le mieux serait de trouver le coupable parfait, surtout pas bien aidé par sa balle de golf retrouvée près du corps, l’embrouiller avec des techniques de flics bien rodées (le coup de la pomme, autre gag), lui faire signer un papier attestant de sa culpabilité, et le tour est joué. On retrouve donc de nouveau cette critique acerbe du milieu, aussi bien sur le terrain que dans les bureaux, l’entourage profite d’ailleurs également de ce traitement de choix avec un portrait d’avocat véreux préférant se saouler avec deux trois escort-girls dans un établissement de karaoké plutôt que d’aider son client. Face à une difficulté qu’il juge insurmontable, il préfèrera abandonner l’affaire et conseiller à la mère de l’interner : il en aura pour quatre ans, qu’est-ce que c’est quatre ans ? Une période espaçant deux coupes du monde de foot, comme précisé au-travers d’un clin d’œil au parcours phénoménal de la Corée du sud en 2002 (The Host montrait de son côté un extrait de la coupe du monde 2006, grand fan de foot le Bong ?), et occasionnellement faisant office d’un autre gag tranchant radicalement avec la détresse affichée de la mère, inondant pourtant le film : la peur de voir son fils incarcéré se lit sur son visage, se devine au travers d’un regard perturbé, déterminé. La bonne femme est d’ailleurs plus ou moins à côté de la plaque, notamment lorsqu’elle décide d’aller fouiller en toute illégalité le repère du meilleur ami de Do-Joon, un type tout de même douteux. La séquence, climax au suspense affolant (comment couper le souffle du spectateur avec un jeu autour d’une bouteille d’eau renversée ?) pose les bases du film, annonce gentiment que si l’on rigole vraiment dans Mother, notamment lors d’une première demi-heure façon farce, c’est pour mieux être pris de revers par la suite, la claque n’en sera que plus grande ou douloureuse, c’est au choix. Car c’est à peu près clair, Mother n’est pas le gros mélodrame pressenti lors des premiers jets accompagnant sa promo. Vrai film de cinéma, on le sait déjà, avec une mise-en-scène alignant les instants de bravoure toutes les dix minutes (gros plans sur des petits détails et sur les visages aux traits volontairement grossis, façon western guignol, distance, plans-séquence, sens du raccord puissant, virtuosité chaotique par l’usage réussi du filmage caméra sur épaule) jusque dans son plan final sidérant, et s’autorise quelques ruptures de ton efficaces. Car autant l’introduction annonce déjà l’entourloupe, dans le genre comédie musicale barrée à la Tsai Ming-Liang, dont on se demande ce qu'elle vient foutre ici, autant la suite représente la synergie parfaite des genres abordés par Bong Joon-Ho depuis ses débuts : la rupture, donc, mais aussi l’audace de mêler au sein d’une même œuvre drame personnel, thriller étouffant, comédie pathétique et clins d’œil par paquets de douze. Autant l’on rigole de la trogne de types douteux, comme les deux étudiants pas très clairs questionnés par la Mère puis passés sauvagement à tabac par un type payé pour, autant l’on a mal pour eux tant la violence est sèche, cartoonesque, jouissive comme pouvait l’être celle d’un Memories of Murder. Cette brutalité, on la retrouve aussi dans le hors-champ par la simple utilisation du son. Jouissif et complet à tous les niveaux. Enfin, l’histoire en elle-même réserve bien des surprises. D’où la proximité avec Memories of Murder, ce même sens implacable du dispositif narratif, ces fausses pistes donnant raison puis tord à la Mère (ou vise versa) par l’intermédiaire de reconstitutions très personnelles de cette dernière s’improvisant détective privée dans le but de comprendre le meurtre de la jeune fille. Et la force du film est de ne pas juger cette dernière, elle n’est qu’une personne modeste sans gros moyens, pas plus intelligente que la moyenne, ses démarches pour prouver l’innocence de son fils ne relèvent-elles par d’un simple amour aveugle pour ce dernier ? Autant de questions destinées au spectateur, seul acteur à pouvoir donner des réponses en plein cours de projection, le cinéma de Bong Joon-Ho est un cinéma de l’interactivité. C’est aussi un autre exemple de la force des grands auteurs, ceux qui encouragent le spectateur à se poser des questions, à participer à leur manière à l’intrigue du film. Mother est l’occasion idéale d’affirmer cette donne. Bong Joon-Ho aura donc livré avec ce film-ci du cinéma complet, on l’a déjà dit, somme à peu près très convaincante de tout ce qui fait la force de son cinéma depuis Barking Dogs. On pourrait trouver à redire au sujet du personnage de Do-Joon, souvent cantonné à jouer le simplet durant la première heure avant d’être éclipsé par la Mère (superbe Kim Hye-Ja) dans la seconde, mais son importance n’est tout de même pas à négliger. Rien n’est d’ailleurs à négliger dans Mother : un reflet, une photo, un bruit, tout est utile pour l’enquête même si la fausse route est le grand danger. Au spectateur de se perdre lui aussi et de serrer le ventre jusqu’à la dernière seconde du générique. Clairement l’un des films les plus excitants de 2009, et accessoirement le haut du panier du cinoche coréen.



NYMPH
Le film démarre : Nous voila plongés dans une luxuriante forêt thaïlandaise, un long plan séquence nous ballade à travers les troncs d’arbres, les feuillages. Soudain, les hurlements d’une femme viennent perçer le silence ambiant, elle tente vainement d’échapper à ses ravisseurs. La caméra s’éloigne de nouveau (on devine le plan subjectif) et on retrouve les deux criminels, étendus dans un lit de rivière, mort. Ainsi s’ouvre Nymph de Pen Ek Ratanaruang, et d’emblée le ton est donné, le film sera lent et la caméra se déplacera tel un boa pachydermique au milieu d’une histoire d’esprit qui pourrait faire frémir plus d’un. En fait non, ce film ne fera peur à personne et pour être tout à fait honnête cela ne semble pas être les préoccupations du jeune auteur. Loin d’être une énième histoire de fantômes façon The Ring (1999) (Zero Bis Versus Code Veronica ….), Nymph se concentre sur l’histoire d’un couple qui se déchire et sombre peu à peu dans la folie. Rien de condamnable en soit, si le réalisateur n’avait pas choisi une mis en scène paresseuse et un peu facile. La forme ressemble vaguement à du Lars Von Trier, une caméra flottante, une image délavée et une lumière faiblarde, je sais c’est réducteur mais je ne suis pas fan, d’autant plus qu’il s’agit du réalisateur de Invisible Waves (2006) et Ploy (2007) qui étaient infiniment plus soignés et graphiques. Le souci de ce film tient dans ce qu’il raconte, ça reste poussif et l’intrigue n’a au final pas grand-chose à nous offrir. Résultat, des plans interminables, certes travaillés pour la plupart, mais franchement pas palpitant. Quant au duo d’acteurs, ils restent dans la moyenne, un peu morne mais plutôt en accord avec les personnages qu’ils interprètent. A noter que l’actrice Temthanaporn Wanida est absolument incroyable … physiquement. Aucun rapport avec le film ? Non, mais on constatera (avec plaisir) que Pen Ek ne choisit pas ses actrices au hasard, souvenez vous de Boonyasak Sinitta (alala !) dans Last Life in the Universe (2003) . Vraiment, on lui reconnaît au moins ce talent … Plus sérieusement et pour conclure, Nymph est loin d’être sans qualités, de jolis plans, certaines séquences sont même carrément inspirée (non mais c’est vrais …) mais le scénario et la forme adoptée n’aident pas le film. A la fin de la séance, je suis resté un peu perplexe et un peu endormis. D’habitude fan de ce réa, j’ai l’impression que cette fois ci, il se repose beaucoup sur ses lauriers. On lisait ça et là que le dernier Pen-Ek Ratanaruang n’était pas génial. Il divise tellement que la sensibilité du spectateur peut faire la différence à tout moment. D’ailleurs, le cinéaste aussi peut faire la différence n’importe quand, on appelle ça le talent. Car autant le dire très vite pour être débarrassé, Nymph n’est pas un grand cru de la sélection cannoise, ni même de son auteur. Il met en scène un couple, Nop et sa femme May, tous deux partis dans la jungle afin d’y réaliser un reportage-photo, le mari étant un grand passionné de photographies. En revanche, May ne semble pas très motivée quant à l’idée de camper dans la jungle, de plus la relation qu’elle entretient avec son mari est extrêmement fragile, ce dernier confiera d’ailleurs qu’il aura négligé son couple à cause du travail, et May, d’aller voir ailleurs, chez son patron. Après Ploy, le cinéaste replonge dans la cassure du couple, motrice de la narration, et l’utilise pour poser le film sur les rails du fantastique : c’est par le travail (et donc, l’élément qui brise le couple) que Nop et May vont se rendre dans la jungle, un voyage qui s’annonce plus étrange que prévu. Ce n’est pas seulement la forêt pénétrante qui passionne tant Nop, amateur de clichés. Non, ce qui attire son attention plus que tout, c’est cet arbre. De forme étrange, il semble presque habité par un esprit. Est-ce le cas ? L’introduction (un plan-séquence démentiel de plus de cinq minutes parcourant la forêt en long et en large) montre une jeune femme se faire attaquer et sans doute violer par deux brutes. Il s’est passé quelque chose en hors-champ puisque deux minutes plus tard, les corps des deux hommes gisent dans l’eau, inconscients, morts. Mais quid de la jeune femme ? Son esprit s’est-il réincarné dans cet étrange arbre, celui qui semble attirer Nop dans un tourbillon d’amour qu’il ne connait plus depuis un bout de temps, jusqu’à le faire disparaître de la Terre ? A nouveau, le cinéma de Pen-Ek Ratanaruang mêle irréel et réalisme, offrant ainsi des moments hypnotiques revoyant l’intérêt du film à la hausse : le rythme, d’une lenteur quasi complaisante, est un de ses points noirs et mettra à mal le courage même des plus endurcis. Assurément le film le plus lent de son hauteur, et paradoxalement l’un des plus exigeants dans la mesure où, au-delà de la structure très simple de son récit, Nymph aligne les séquences inutilement trop longues avec une nonchalance pas possible. Le réalisateur semble trouver un malin plaisir à imager la lassitude de May à coup de caméras errant autour de son couple, fragiles, presque dépressives. Et à l’image de Ploy, on retrouve une scène de pleurnicherie dans une salle de bain, l’infidélité traitée en filigrane, un élément perturbateur (Ploy dans…Ploy contre l’arbre mystique ici) et le sens de la rupture. Vitamine du cinéma d’auteur thaïlandais, celui qui perce en festival, l’imprévisible fait partie des éléments qui font la différence. Aussi bien chez Pen-Ek que chez Apichatpong, un évènement vient très souvent en cours de métrage secouer quelques fondations bâties sur une lenteur «marque de fabrique », et ce Nymph que l’on aurait aimé détester (ce serait une première dans le cinéma de Pen-Ek Ratanaruang) prend le dessus , rappelle au spectateur qu’il sait être admirable le temps d’une poignée de séquences marquantes : l’introduction d’abord, si longue que l’on est obligé de crier au sal géni, la disparition de Nop, ou encore la nymphe le « dévorant » dans ses racines sont autant de moments de vraie intensité, permettant à un film globalement feignant de sortir la tête de l’eau par éclairs. Le reste n’est que brume, manque d’inspiration, et tendance à s’éterniser là où ce n’est pas nécessaire. Cette lenteur d’ensemble renvoie directement au personnage de Nop joué par l’anti-charismatique Jayanama Nopachai, auteur d’une performance médiocre. De son côté, Tempthanaporn « Gibzy » Wanida s’en sort bien mieux, forte d’une beauté tranquille et d’un charisme tel qu’il lui permet de véhiculer des émotions plutôt noires. Formellement, le film est très inégal. On retrouve la patte du cinéaste dans ces plans à rallonge, ces quelques travellings hypnotiques, ce sens pour la durée censée faire ressortir de l’image tout son pouvoir irréel, malheureusement quelques tics pas bien utiles viennent gâcher l’ensemble, comme une caméra sur épaule vite fatigante lorsqu’elle est utilisée de manière artificielle (c'est-à-dire 80% du temps). A côté, Kawase Naomi filme mieux la nature. Mais rayon réconfort, le son est toujours aussi dément, le bruit du vent dans les feuillages, le courant de l’eau, tout participe à l’immersion malgré l’absence de sourdine chère à ses films depuis Last Life in the Universe. Au final s’il n’est pas mauvais, Nymph ne parvient jamais à être totalement convaincant, sans doute parce qu'il affiche une facette du cinéaste qu'on ne connaissait pas réellement, malgré de petits clins d'oeil. On est en plein dans la tambouille. Enfin, annoncé comme un film d’épouvante érotique, on y trouvera bien plus d’horreur dans un Vagues Invisibles qu’ici, et bien plus d’érotisme dans Ploy. Frustrant car au potentiel tellement fort, Nymph arrive pourtant à être captivant dans la manière dont il métamorphose ses personnages : May se rend compte qu’elle n’a pas assez profité de son couple au moment où son amant rompt avec sa femme et au moment où Nop (son spectre ?) réapparait sous la forme d’un homme, mais blindé de racines à l’intérieur (ses nombreux verres d’eau engloutis en sont un bon exemple). Mais si l’idée sur le papier est excellente, le traitement reste trop souvent en surface. Il serait tout à fait possible d’allonger la liste d’idées excellentes entachées par un manque d’inspiration, prouvant l’inégalité totale de Nymph, mais on s’arrêtera à ce constat : l’œuvre est fascinante, dérangeante, pénible et fatiguante. Rien que ça.
SPRING FEVER (Lou Ye)
Lou Ye, banni de Chine en 2006 à cause de son film "Une jeunesse chinoise", enfonce encore plus le tison ardent de la liberté individuelle dans les flancs des autorités conservatrices avec son dernier projet : Spring Fever, tournage clandestin ayant pour toile de fond l'homosexualité masculine. L'ouverture de Spring Fever n'est pas sans rappeler "Happy Together (1997) " de Wong Kar Wai. Hélas, la comparaison s'arrête là. En effet, avec ce film nous sommes confrontés à une sorte de réalisme cru façon documentaire à coups de plans portés à l'épaule sans la moindre composition. Durant 1h55 ce n'est qu'une succession de cadrages hasardeux assemblés par un montage d'usine, de séquences transitoires souvent sans grand intérêt. Cette photographie à la banalité outrancière et les innombrables longueurs desservent implacablement les changements de ton, si bien que l'intrigue de cette fiction-brouillon ne fonctionne pas. Malgré les risques encourus par l'engagement de son auteur et de ses collaborateurs, Spring Fever ne dégage rien.
TAKING WOODSTOCK (Ang Lee)
Nouvelle réussite d'Ang Lee qui nous livre avec Taking Woodstock un film à la fois intéressant et divertissant sur la génèse et le déroulement du festival de Woodstock. La narration intègre l'histoire personnelle d'un témoin de l'époque, Elliot Tiber, dont les mémoires de jeunesse ont servi de base de travail au scénario. Cette facette intime du film colle parfaitement au contenu historique et permet d'illustrer le contexte sociologique d'une époque en pleine mutation, le tout sous couvert d'humour burlesque et bon enfant. La réalisation assez rythmée utilise occasionnellement le super 8 et le montage en split screen, restituant ainsi idéalement l'ambiance vidéo d'il y a 40 ans et plus particulièrement du documentaire de Michael Wadleigh de 1970 pour lequel Martin Scorsese avait participé. C'est par rapport à ce documentaire fleuve que Taking Woodstock a préféré s'orienter sur les festivités au coeur de la foule et non sur scène. Il ne pouvait y avoir meilleur choix.
THIRST (Park Chan Wook)
En partie inspiré d'un roman d'Emile Zola, Thérèse Raquin, Park Chan-wook propose une recette multi-genres avec de la comédie, de l'érotisme, du drame amoureux, et des vampires sous stéroïdes façon Anne Rice. En dépit de ce maelstrom de sensations alléchantes, Thirst n'est pas à la hauteur des précédentes livraisons du réalisateur. Certes Park Chan-wook sait filmer mais trop de défauts structurels ou de choix contestables entâchent la bonne vision d'une oeuvre aussi bigarrée. Prenons par exemple les excès de maniérisme que l'on trouvait déjà dans "Sympathie for Lady Vengeance où certains plans lèchés étaient juste élaborés pour le plaisir d'être placés en dehors de toute considération rythmique. Ici ce sont des effets spéciaux tape à l'oeil qui viennent se poser comme une mouche dans l'assiette du cinéphile exigeant. L'intrigue quant à elle est laborieuse, longue à s'enclencher, et le basculement entre les genres s'opère sans réelle harmonie. Thirst n'arrive pas à trouver son identité et seule l'ambiance huit-clos de la dernière demi-heure sauve le film. A l’instar de l’œuvre d’un Bong Joon-Ho, chaque nouveau film de Park Chan-Wook est attendu comme un évènement auprès de la planète cinéphile qui aura subi en 2003 l’électrochoc Oldboy. Après une pause en forme de récréation maladive, dessinée sous les traits d’une comédie loufoque lorgnant du côté de la science fiction, le mal aimé Je suis un cyborg, Park Chan-Wook revient au genre qui le fit connaitre, le film pulsionnel par excellence, dévoreur d’âmes égarées dans les salles obscures. Obscure, Thirst l’est clairement. On ne va pas revenir cent-sept ans sur le pitch du film (calqué sur la structure du Thérèse Raquin d'Emile Zola), tout le monde le connaît après l’énorme buzz qui entoura « le dernier film de Park Chan-Wook », qui n’aura pas succombé à la tentation de le numéroter comme auraient pu le faire un Tarantino, Kim Ki-Duk ou encore Liu Fendou. Néanmoins ce n’est pas pour autant que le cinéaste se fera des amis avec cette nouvelle variation du mythe du vampire, puisque Thirst ne diffère pas grandement de ce que l’on a déjà vu dans l’œuvre du « boucher coréen » comme l’a si gentiment surnommé un rédacteur de Chronicart. On retrouve un prêtre livré à lui-même, comme l’ont été Oh Dae-Su (Oldboy) ou Geum-Ja (Lady Vengeance) après leur sortie de taule, se portant volontaire pour une expérience en Afrique. Il en reviendra gorgé de virus, mais contrairement aux cinq-cents autres cobayes, bel et bien vivant. Un virus que l’on distingue par la formation de pustules purulentes sur le corps de ce dernier, dont il peut se débarrasser en buvant du sang frais. Ce qu’il ne tardera pas à faire pour cacher sa maladie à celle pour qui son cœur bat encore, la belle Tae-Joo. En venant au chevet de son frère malade, il se rappellera d’elle à l’époque où ils étaient adolescents. Au départ timide, leur relation prendra une tournure beaucoup plus forte et passionnelle à mesure que Sang-Hyun sirote pour survivre. Comme il le dit très justement à un autre prêtre, les vampires ne sont pas immortels. Débarrassé de sa mise en place lente et plutôt sage, ponctuée de scènes sanglantes qui font du bruit –logique lorsque l’on vomit du sang par litres, Park Chan-Wook aligne les séquences au très fort pouvoir érotique, instants sulfureux uniques dans l’œuvre du cinéaste. Pour la rigolade, Thirst est considéré comme un Twilight saignant, comparaison aussi risible soit-elle puisqu’on y baise au bout d’une demi-heure. Et quelle baise mes aïeux, terme volontairement vulgaire car ce que l’on voit à l’écran n’a pas grand-chose de très sensuel : on y lèche les doigts, les pieds ou encore les aisselles –les amateurs de AV japonais seront servis !- comme une bête le ferait sur son morceau de gigot saignant. Charnelles et fusionnelles, les séquences érotiques masquent le désespoir des personnages, tous plus ou moins misérables. Sang-Hyun est réduit à se nourrir de sang s’il veut rester présentable et vivant, Tae-Joo vit dans une famille de demeurés qui la traite en esclave, elle rêve de s’évader et de vivre un jour nouveau bien qu’elle ne soit pas tout à fait claire non plus. Une fois bien entamé, au moment où la relation entre les deux êtres est à son paroxysme –un pêché en lui-même puisque la tentation est bannie du cahier des charges des hommes de l’église, la folie va s’emparer de l’être que l’on pensait faible, et à Park Chan-Wook de piéger son audience en inversant le rôle des bourreaux, à défaut que Sang-Hyun se nourrissait jusque là sans tuer. Une de ses techniques était par exemple de siroter par intraveineuse le sang d’un chouette type dans le coma, manière plutôt polie pour se rassasier. La belle et outrageuse jeune femme ira à la pince coupante, c’est tellement plus simple. L’art malpoli de Park Chan-Wook est d’ailleurs de ricaner du sort de ses personnages, de mettre en image leur désespoir sous forme d’humour, comme lorsque Sang-Hyun explique à Tae-Joo qu’être vampire c’est simplement avoir un régime alimentaire différent, ou lorsqu’il lui montre la manière dont il se nourrit en s’allongeant par terre, intraveineuse au bec. Cet humour deviendra encore plus pinçant dans son épouvantable avant dernier acte, où Tae-Joo s’amusera à massacrer sa famille, la rendant détestable et méprisante. On peut en l’occurrence reprocher à Park Chan-Wook de déshumaniser de manière complaisante ses personnages, de rire de leur sort en les écrabouillant sans gêne. Femme brisée, mère de famille devenue paralysée et qui assiste aux joyeuses fiestas sanglantes dans son propre salon, incapable de bouger le petit doigt, ou encore un mari noyé revenant narguer ses bourreaux dans des hallucinations au fort pouvoir graphique. L’habillage du film est d’ailleurs terrible. « Terrible » lorsque ce terme est vulgarisé, c'est-à-dire une mise en scène qui jouit comme à l’accoutumé d’une précision évidente, elle n’évoque rien mais frappe la rétine, obsession d’un cinéaste qui aura forgé ses talents de metteur en scène par une solide cinéphilie. « Terrible » également dans sa gravité, cette même mise en scène devient gênante, presque déplacée dans cette orchestration parfois gerbante de la misère humaine, ou le ricanement devient un tic, presque une erreur. Rien ne prête réellement à rire, mais le traitement formel opéré par Park Chan-Wook, admiratif de ce qu’il met en scène puisqu’il fait tout pour la rendre la plus maniérée possible, ne se marie pas toujours très bien avec certains aspects narratifs. Le cinéaste fait certes systématiquement mouche lorsqu’il capte la moindre poésie émanant de l’amour des deux personnages principaux, notamment lorsque Sang-Hyun offre ses souliers aux pieds abimés de sa future belle ou lorsqu’il lui montre en pleine nuit ses pouvoirs sur les toits de la ville. Et dans le dernier acte final, particulièrement réussi car à la tonalité différente de la moiteur crade des décors tout du long, au moment où Tae-Joo se rend compte combien il est en fait bon de vivre, la désagréable sensation d’avoir eu affaire à un cinéaste incapable de faire autre chose que du rentre-dedans sévère et méchant sur toute la ligne casse toutes les fondations construites en cours de route. On se dit alors que la poésie entrevue le temps d’une poignée de scènes absolument merveilleuses n’était que gadget, éphémère, notamment avec ce dernier plan sur les souliers –un symbole, censé être drôle, mais qui rappelle surtout que Park Chan-Wook veut rire jusqu’au bout, et a surtout bien ri, de ses personnages réduits à l’esclavage permanent. Formidable dans sa démarche de s’approprier les codes du film de vampire pour les moderniser, Thirst mérite d’être vu pour ses solutions formelles, ses instants torrides, ses quelques élans poétiques surprenants de la part de l’auteur d’Oldboy et l'interprétation remarquable du tandem Song Kang-Ho / Kim Ok-Bin. Ce qui n'est pas rien. Mais lorsque Park Chan-Wook se complait dans le crade, le massacre et le ricanement discret mais permanent sur le sort réservé à chaque personnage, difficile d’adhérer à une telle manière de voir les choses. Le cinéaste confiait en interview que l’humour rend les séquences plus épouvantables encore. De là à le tolérer…
VENGEANCE (Johnnie To)
Tous les fans du mythique réalisateur Hongkongais pouvaient légitiment se poser la question : Que pouvait bien donner un projet réunissant Johnnie To et Johnny Hallyday ? Les premiers avis ont étés majoritairement négatifs. Les doigts accusateurs se sont pointés vers le vieillissant rockeur frenchie qui n’avait jusque-là pas forcément excellé dans le domaine du cinéma. Mais détrompez-vous tout de suite ! Vengeance vaut largement le détour et bien que la présence de Hallyday était à craindre, rien ne justifie le désaveu total de cet énième mais juteux polar signé par monsieur Johnnie « Balle de Beretta » To ! Vengeance se base sur un scénario très simple, une histoire de Vengeance (sans rire …) comme on en a vu des centaines : Johnny Hallyday alias Francis Costello apprend l’assassinat tragique (et délicieusement brutal …) de sa fille (et petits enfants, et mari …) et décide de voler jusqu’à Hong Kong pour imposer sa justice. Arrivé sur place, il y rencontre un trio de tueur à gages endurcis (Anthony Wong, Lam Suet et Gordon Lam) et décide de les enrôler dans son expédition punitive. Très simple le script … mais qu’importe le script ! Le film est une preuve de plus que le réa maitrise son genre de film fétiche, à savoir le polar noir sans fioritures, tout en enchaînant les séquences décalées portant sa signature. On retrouve ainsi les scénettes digne du jeu de foot « boule de papier » et « canette » de The Mission (1999) et Exiled (2006) , toujours aussi jouissives et subtilement distillées tout au long du film. La mise en scène de Johnnie To est précise, ses cadrages rendent une fois encore hommage au cinéma de Léone avec ses acteurs qui prennent la pause, mais toujours avec élégance et classe. La référence au cinéaste Italien va même jusqu’à un clin d’œil direct à la séquence légendaire d’Il était une fois dans l’Ouest : « Maintenant qu’il a vu ton visage … Tu sais ce qu’il te reste à faire ! » Johnnie To s’entoure d’ailleurs de comédiens qui ont fait sa réputation et la palme revient cette fois (encore une fois plutôt !) à Anthony Wong qui est saisissant dans le rôle d’un tueur à gage froid, consciencieux mais roublard et sympathique à la fois. Evidemment un cliché ! Mais du cliché de cette prestance (Catégorie 3 Superstar bonsoir !) on en redemande ! Johnny Hallyday est certes à côté de la plaque, mais toute l’intelligence de To est de faire parler un minimum sa star française, lui offrant un rôle de vengeur / poseur (le chapeau et le manteau font partie du personnage) et évite ainsi de mettre en péril son film par le jeu aléatoire de son comédien. Mais ne soyons pas élitiste, le quatuor d’acteur fonctionne à merveille et on excusera rapidement certains passages un peu hasardeux, notamment une séquence ou Hallyday prie, l’eau jusqu’au cou, et revoit les fantômes de sa « tragédie » … ridicule oui, mais un détail au vu du reste. Enfin pour couronner ce festin cinématographique, on a même droit à une séquence finale digne des Heroic Bloodshed obscurs mais festifs des années 80 / 90 (Flaming Brothers (1987) , Rock N' Roll Cop (1994) et j’en passe et des meilleurs). Nos trois acolytes chinois « les frères » se retrouvent alors armés jusqu’aux dents et prêt à en découdre devant une armée d’homme de mains brandissant le traditionnel calibre. La suite on l’imagine aisément et le plus drôle c’est que ca se passe avec le sourire et les cabotinages de Simon Yam (hilarant en chef de guerre digne d’un Shaw Brother) incapable de se servir d’un fusil à lunette. Que demande le peuple ? Que demandent les fans nostalgiques et trop longtemps méprisés par des productions "millenium pop" et boiteuses ? La réponse est simple et efficace : Bang Bang Bang Bang Bang ! Vengeance is mine !
Comment ne pas penser aux lyrics du grand Jimi lorsque l’on suit les tribulations de notre Jojo national dans les rues de Macao et de Hong-Kong ? Mais au lieu d’aller flinguer sa nana, il souhaite se venger des types qui ont descendu la famille de sa fille. Par un concours de circonstances, il fera la rencontre dans un luxueux hôtel à Macao d’une bande de trois tueurs à gages menée par Kwai (génial Anthony Wong) et louera leurs services pour une montagne d’argent, une maison et un restaurant à Paris, « in Les Champs-Élysées ». Ca ne se refuse pas. A côté ça, de l’art. Vengeance n’est pas un point de bascule, ni une tentative pour Johnnie To de renouveler son cinéma malgré le fardeau que représente un tournage où, pour une fois, l’un de ses protégés n’a pas le rôle principal. Ce n’est donc ni Anthony Wong (d’une classe fabuleuse, tout en souplesse même lors d’un dernier souffle), ni Gordon Lam ou Lam Suet qui tiennent la barque. C’est Johnny, un gweilo parmi tant d’autres à Hong-Kong, qui tient le film à bras le corps, par sa prestance assez peu commune, sorte de mélange de surcharge dans la lassitude, fardeau lui-même à cause d’une mémoire vacillante à chaque choc, silhouette spectrale qui ne sait même plus ce que le terme vengeance veut dire –là aussi rien de bien commode lorsque le film pointe dans son viseur la thématique de la vengeance, émouvant même dans toute sa théâtralité lorsqu’il prie le seigneur (quel seigneur, d’ailleurs, quand on sait ce que sont devenus les membres de sa famille) ou lorsqu’il entame une partie de foot improvisée –et improbable- sur la plage avec des gamins eurasiens. L’art de la rupture ? Johnnie To la manie à merveille dans la direction de ses acteurs, chaque scène impliquant la famille d’hommes de mains recomposée (Johnny, les trois tueurs à gage) entraîne une surprise, un truc imprévisible pour le premier venu mais tout à fait convenu –et donc jouissif- pour le spectateur averti : un repas, une partie de foot, un terrain transformé en stand de tir, des rires. Une rupture également dans toute la dimension du terme « action », si galvaudée à partir du moment où il y a un échange musclé dans une situation quelconque. Ici, plus que tout ailleurs, la rupture est dans le style. Lorsque To filme les séquences de dialogues entre les protagonistes, il le fait de manière classique (comprenons par là, en connaissant le personnage, comme dans un western avec un formidable jeu des perspectives), mais la machine se met en route lors de chaque affrontement : chorégraphies, danses, pluie de balles en forme de ballet, ralentis omniprésent pour découper l’affrontement, le sublimer, le préciser également grâce à un sens de l’espace souvent féroce. A titre d’exemple, le gun-fight au clair de lune est simplement l’une des plus belles trouvailles du polar moderne, jouant avec la lumière et la pénombre tout en précisant la position des tireurs grâce aux explosions des balles. Filmée essentiellement en travellings lattéraux, la grosse séquence d'action suivante sera filmée cette fois-ci à la verticale (un style tout en perpendicularité, bien pensé). Une mise en scène impressionnante, donc, à l’image de cet affrontement mémorable précédé d’une rupture dans la plus pure tradition de Johnnie To : Johnny et sa bande arrivent sur une aire de pique-nique où sont postés les trois tueurs responsables de la mort de sa famille. Ils approchent, le cadrage passe en mode western, la famille des vilains débarque et les enfants rigolent avec leurs papas et lancent le barbecue. Les bons montent plus haut, se positionnent, deux minute plus tard les gosses des vilains leur apportent des saucisses. Un boomerang vole dans les airs, survole Johnny et ses hommes de main. Un signe. C’est juste classe, mémorable dans le sens « on se souvient de cet objet » comme on se souviendrait de ce vélo qui avance au fur et à mesure que les balles ricochent sur sa carcasse dix minutes plus tôt. Le cinéma de To tient à peu de choses, en dehors de sa redite évidente destinée à l’ouverture que Cannes lui a offerte sur la scène mondiale. Il tient à trois scènes, peut-être quatre, fantastiques. Il garde un vrai souffle dans le renouvellement, par contre, toujours aussi constant film après film : après les audaces –un peu ratées- de Mad Detective, To utilise la thématique de la perte de mémoire pour donner vie à une poignée d’idées remarquables comme le jeu des timbres post-it en fin de métrage, collés sur le grand méchant de l’histoire (Simon Yam qui fait du Simon Yam, lourd, mégalo, mais jouissif) par une bande de gosses, pour que Johnny (de plus en plus amnésique) se souvienne de sa cible. Simple mais absolument ludique. Vengeance doit se déguster comme une friandise un peu trop sucrée. On connait le parfum, industriel, peut-être un peu trop, mais le plaisir est constant. On tente parfois de changer les parfums (Johnny), la surprise est parfois désagréable comme ici le comique involontaire (dans la mémoire collective, les hurlements de Johnny nous rappellent, malgré lui, la publicité Optic2000), le navrant (la prière, les fantômes de sa famille), les facilités (les motifs de l’assassinat de sa famille ? Des secrets qui auraient pu être divulgués par le mari…mouais). Mais à côté de cela, une démonstration formelle de tous les instants, un sens du rythme implacable, un personnage de Johnny touchant jusque dans sa lourdeur démonstrative affirmée à coups de gros plans sur son physique pas commode (voir la séquence d’opération douloureuse), trainant sa silhouette de Macao à Hong-Kong, entre mélancolie, perte de repères et lassitude, pour finir dans l’harmonie et la communion par le rire avec sa nouvelle famille. Restons sur cette image là.
VISAGE (Tsai Ming Liang)
Tsai Ming-liang joue sur ses acquis avec Visage et tombe dans cette facilité qui guette chaque cinéaste. Il met en scène un film sans histoire, un film prétexte à pouvoir laisser son imagination allée au gré de ses envies. Il ne met en avant que l'esthétique et même cet aspect de son oeuvre ne convainc pas toujours. Les acteurs peinent à incarner leurs personnages lesquels peinent à faire avancer le récit. Il en résulte un film décousu, sauvé in extremis par quelques scènes et encore. On souffre, on s'ennui, on s'exaspère devant ce film tant attendu qui finalement déçoit. On ressort de la projection avec un goût amer qui reste un long moment dans la bouche. Pourtant, les moyens avaient été donné à l'auteur taïwanais pour qu'il puisse jouir d'une totale liberté, sans aucune contrainte, si ce n'est que sa fiction se déroule en grande partie au Musée du Louvre. Voilà ce qui manque à Tsai Min-liang, des contraintes qui auraient sans doute permis à son oeuvre d'être diiférente et d'offrir un autre visage que ce visage moribond parfois incompréhensible, dénué de sens et lassant...
YUKI ET NINA (Suwa et Girardot)
Yuki et Nina, le plus japonais des films français ? Le film du duo Suwa/Girardot n’a pas besoin de scénario très écrit pour exister, ni pour faire valoir son authenticité et sa faculté à mêler imaginaire et réalisme social au sein d’une même œuvre pleine de légèreté et de puissance émotionnelle. Le film a beau être filmé à hauteur d’enfant, se dérouler dans les beaux quartiers de Paris et tenir des propos volontairement naïfs, il dégage suffisamment de force et de cœur pour intéresser et captiver. Cette réussite, on la doit à l’alchimie de deux profils résolument différents, celui de Hippolyte Girardot qui s’essaye à la réalisation et à l’écriture, une première pour cet acteur français, et celui de Suwa Nobuhiro, réalisateur appartenant à la Nouvelle Vague d’auteurs nippons apparue au milieu des années 90 et amateur de toute forme d’improvisation à l’écran (voir Mother). L’improvisation, comme le soulignait Hippolyte Girardot, est récurrente lors des échanges entre Yuki et Nina, rien de plus normal lorsque le film donne la vedette à deux enfants : le cinéma n’est qu’un outil pour raconter une histoire, mais les enfants restent des enfants avec leurs expressions pleine de naïveté et une vision de la vie, du haut de leur 1m20, qui leur est propre. On ne peut pas le leur voler. Yuki est une petite fille franco-japonaise dont les parents sont sur le point de se séparer définitivement. Sa mère prévoit de partir avec elle au Japon pour s’y installer, malgré le refus de cette dernière. Elle n’a qu’une amie, Nina, petite parisienne au fort caractère. Son père ne comprend pas réellement cette idée saugrenue, pour lui, le Japon c’est un pays de fous. Les deux petites vont donc imaginer tout un tas d’idées pour convaincre les parents de Yuki de se remettre ensemble, mais la question de la séparation n’est pas aussi facile qu’une belle lettre rédigée par les deux enfants, colorée et pleine de gommettes, destinée à les convaincre. Comme tente d’expliquer Jun à sa fille, il est triste de se séparer, mais rester ensemble est sans doute pire. La gamine, du haut de ses yeux d’enfants, a du mal à concevoir une telle idée et à la réception de cette lettre, signée par la fée de l’amour, Jun fondra en larmes. Mais au contraire d’une tombée dans le larmoyant et les bons sentiments, la scène ne mènera à rien de très positif et engagera une conversation avec d’un côté la raison incarnée par la mère et la naïveté par la petite Yuki, le film ne cesse d’ailleurs de confronter au sein d’un même cadre, d’un même lieu, l’enfance et le quotidien délicat des adultes pour une explosion d’émotions attendue, à l’image d’un orage provoqué par un choc de températures contraires. Mais Yuki et Nina n’est pas qu’une chronique sur l’enfance et le couple, installée dans les beaux quartiers de Paris qu’une sitcom n’aurait pas renié. Il y a une magie enfouie derrière l’image lisse et élégamment photographiée, privilégiant des plans sans coupe pour affirmer l’authenticité et le naturel qui priment sur tout autre facteur. Car c’est en partie par le charisme de Yuki que le film prend régulièrement son envol et provoque le ralliement du spectateur à ses côtés, Nina ne reste qu’une petite fille aimable mais trop insolente. Néanmoins, la fugue qu’elle entreprend dans le dernier tiers la montre sous un jour nouveau, plus délicat et moins fonce-dedans à la manière d’un trente-tonnes lâché sur la Route 66. Elle prend l’initiative de mener la barque, file en compagnie de Yuki vers la maison de son père car toutes deux sont enfants de parents divorcés ou sur le point de l’être, et c’est parti pour l’aventure en forêt, représentant souvent une figure métaphorique de l’évasion. D’ailleurs, au moment où les deux petites se perdent de vue, Yuki se retrouve seule, livrée à elle-même, se frayant un chemin parmi les feuillages ou comment mettre en image son propre parcours initiatique, sa propre manière de grandir par la débrouillardise. Le film basculera à cet instant dans un autre monde, exacerbant s’il était encore nécessaire l’approche fantastique –au sens propre- de son récit : ou comment rappeler également une certaine idée du cinéma de Kawase Naomi et ce rapport très fort entretenu avec la nature et le spirituel. Yuki et Nina culmine alors vers des sentiers qu’on ne soupçonnait guère, et en quittant Paris, livre une fable encore plus douce et rassurante sur l’avenir de la petite Yuki en compagnie de, qui sait, ses futures amies et une grand-mère plus familière qu’elle n’y paraît. Le spectateur pas tout à fait familier avec ce genre d’audaces narratives, très proches du songe, n’y trouvera qu’un film « superficiel » comme s’offusquait mon voisin de droite durant la projection de Et là-bas quelle heure est-il ? de Tsai Ming-Liang. Il n’y comprend tout simplement rien ou n’est pas encore prêt à comprendre ce style de procédé distordant le temps et l’espace sans prévenir. On ne lui conseillera pas le cinéma de Weerasethakul non plus ou toute autre oeuvre sensorielle. Ce beau portrait de l’enfance n’a rien à voir avec ces comédies US où les mômes finissent par faire réconcilier leurs parents à coups de baguette magique, et dieu merci le happy end n’est pas de la partie. La vie suit logiquement son cours, de manière attendue, comme cette pluie légère s’abattant sur les régions humides et verdoyantes du Japon auquel le film nous y convie, pour un dernier moment entre poésie et magie nébuleuses.
PETITION (ZHAO Liang)
PETITION est un documentaire réalisé par un chinois de manière clandestine sur le bureau des réclamations à Beijing. La situation y apparaît dramatique, mettant en évidence les dysfonctionnement du système. Les victimes d'injustices venus de province, en conflit avec les autorités locales, restent parfois plusieurs années, vivant dans des conditions rudimentaires dans des campements alentours, espérant voir un jour leur cas étudié et la justice enfin rendue. Le plus souvent ils n'obtiennent rien d'autre que des menaces ou des coups de rabatteurs, des personnes "noires" aux ordres des tyrans provinciaux. Le sujet est grave, le style est brut de réalisme, les protagonistes suscitent l'empathie, PETITION est donc réussi, un documentaire coup de poing parmis les plus marquants que j'aie pu voir sur la Chine, bien plus intéressant que n'importe quel JIA zhang ke pour ne citer que lui.