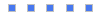
 On s’entendra tous sur un point : Le festival de Cannes est une mine rare de films qui ne demandent qu’à être appréciés... ou subis. Alors on apprécie, ou on subit, mû par la même cinéphilie fanatique, et assez rapidement, un tel marathon devient inévitablement épuisant : les jambes se font lourdes, les yeux opaques, et monseigneur l'astre solaire fait lentement mais sûrement crépiter la peau de ses rayons caniculaires.
On s’entendra tous sur un point : Le festival de Cannes est une mine rare de films qui ne demandent qu’à être appréciés... ou subis. Alors on apprécie, ou on subit, mû par la même cinéphilie fanatique, et assez rapidement, un tel marathon devient inévitablement épuisant : les jambes se font lourdes, les yeux opaques, et monseigneur l'astre solaire fait lentement mais sûrement crépiter la peau de ses rayons caniculaires.
Mais venons-en plutôt à l'essentiel, le versant asiatique de l'édition 2007, cru fort sympathique qui finalement ressemble aux précédents, composé de films de qualité très variable, classique refrain dont on se lassera probablement jamais !
Nassim Maoui et Fredéric Caccialupi
Remerciements : Carole Choucoutou, Jean Charles Canu, Frédéric Henry, Yann Kerloch, Olivier Lehman, Jean Pierre Guimenez, Frédéric G
COMPETITION
My BlueBerry Night, de Wong Kar Wai, Hong Kong
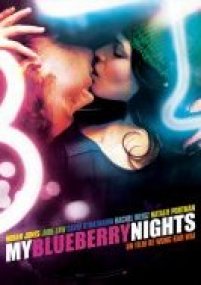
Après le médiocre 2046, Wong Kar-Wai avait décidé de réinvestir le Festival de Cannes, toujours affublé de la même paire de lunettes, avec cette fois-ci son premier film tourné aux Etats-Unis. Imaginez : Norah Jones (!), Jude Law ou encore Nathalie Portman, plongés dans un tournage imprévisible dont seul le réalisateur hongkongais a le secret... Las ! Le film se révèle être une triste parodie de Chungking Express. Une histoire de cœur brisé (Norah Jones, pitié...) qui gravite autour d’un café (tenu par le souriant et bronzé Jude Law), et qui donne lieu à d’interminables conversations métaphoriques qui laissent perplexe. Wong Kar-Wai se regarde filmer et ses fameux ralentis (au hasard, la cigarette portée à la bouche) en deviennent dès lors convenus et faciles, soit l'ombre d'eux-mêmes. Où est passée toute la subtilité de ce réalisateur qui savait si bien filmer les êtres ? En tout cas pas dans cette seconde erreur qui ne bernera personne. Quant aux larmes de Natalie Portman, elles sont comme le film : artificielles.
La forêt de Mogari, de Kawase Naomi, Japon
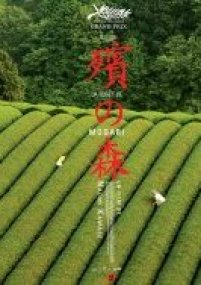 Rarement un titre n’aura autant donné le ton d’un film, à condition de savoir le déchiffrer. Mogari, c’est la période consacrée au deuil, voire le lieu du deuil. D’où cette forêt ambivalente où une jeune femme qui a perdu son fils et un veuf âgé et inconsolable vont pleurer leurs défunts et faire la paix avec eux. Le chemin de l’apaisement selon Kawase Naomi est long et juché d’embûches, mais surtout lourd de symbolisme et d’ennui : la nature déchaînée figure la violence des sentiments, les deux survivants inversent peu à peu leurs rôles, chacun rappelant à l’autre le cher disparu, un sac à dos débordant de carnets évoque la douleur de l’absence… Et bien sûr, les deux êtres blessés qui ne se savaient plus vivants, vont soudainement reprendre goût à l’existence. On comprend où la jeune réalisatrice veut en venir, mais il nous est impossible de la suivre tant son interminable périple, allégorie contemplative impuissante à transmettre les émotions les plus simples, s’avère lassant et dépourvu d’intérêt.
Rarement un titre n’aura autant donné le ton d’un film, à condition de savoir le déchiffrer. Mogari, c’est la période consacrée au deuil, voire le lieu du deuil. D’où cette forêt ambivalente où une jeune femme qui a perdu son fils et un veuf âgé et inconsolable vont pleurer leurs défunts et faire la paix avec eux. Le chemin de l’apaisement selon Kawase Naomi est long et juché d’embûches, mais surtout lourd de symbolisme et d’ennui : la nature déchaînée figure la violence des sentiments, les deux survivants inversent peu à peu leurs rôles, chacun rappelant à l’autre le cher disparu, un sac à dos débordant de carnets évoque la douleur de l’absence… Et bien sûr, les deux êtres blessés qui ne se savaient plus vivants, vont soudainement reprendre goût à l’existence. On comprend où la jeune réalisatrice veut en venir, mais il nous est impossible de la suivre tant son interminable périple, allégorie contemplative impuissante à transmettre les émotions les plus simples, s’avère lassant et dépourvu d’intérêt.
Secret sunshine, de Lee Chang-Dong, Corée du sud
 La mort, décidément, obnubile les cinéastes sélectionnés à Cannes, et précisément les réalisateurs asiatiques. Lee Chang-Dong met donc en scène le chemin de croix d’une jeune femme qui tente de se remettre du décès d’êtres chers en s’oubliant dans la religion. Hélas pour lui, on ne croit ni aux (nombreux) rebondissements de l’intrigue, ni à la personnalité de l’héroïne pour laquelle il est impossible d’éprouver la moindre empathie. Du coup, ses innombrables crises de larmes ne nous émeuvent pas plus que sa conversion subite, et l’on ne peut que repérer en ricanant les grosses ficelles mélodramatiques qui jonchent son parcours (multiples humiliations, acharnement du sort, inclination à la folie...). Qui plus est, la démultiplication des scènes religieuses dilue un film déjà bien trop long et, histoire de parachever ce qu’il faut bien considérer comme un ratage complet, tout sonne tellement faux, il y a tant d’hystérie et de sentiments outrés, que cette histoire qui aurait probablement dû être sublime se transforme à l’écran en pur grand guignol.
La mort, décidément, obnubile les cinéastes sélectionnés à Cannes, et précisément les réalisateurs asiatiques. Lee Chang-Dong met donc en scène le chemin de croix d’une jeune femme qui tente de se remettre du décès d’êtres chers en s’oubliant dans la religion. Hélas pour lui, on ne croit ni aux (nombreux) rebondissements de l’intrigue, ni à la personnalité de l’héroïne pour laquelle il est impossible d’éprouver la moindre empathie. Du coup, ses innombrables crises de larmes ne nous émeuvent pas plus que sa conversion subite, et l’on ne peut que repérer en ricanant les grosses ficelles mélodramatiques qui jonchent son parcours (multiples humiliations, acharnement du sort, inclination à la folie...). Qui plus est, la démultiplication des scènes religieuses dilue un film déjà bien trop long et, histoire de parachever ce qu’il faut bien considérer comme un ratage complet, tout sonne tellement faux, il y a tant d’hystérie et de sentiments outrés, que cette histoire qui aurait probablement dû être sublime se transforme à l’écran en pur grand guignol.
HORS COMPETITION
Triangle, de Tsui Hark, Johnnie To, & Ringo Lam, Hong Kong
T riangle est un projet aligné sur le principe du "cadavre exquis", à l'initiative du réalisateur Tsui Hark, qui s'est chargé d'écrire et réaliser la première partie, laissant la seconde à Ringo Lam, et la dernière à Johnnie To. L'affiche était prometteuse, ce qui rend la déception encore plus grande car Triangle n'est rien d'autre qu'une grosse marrade qui n'amuse que ses auteurs. L'histoire repose sur un trio de bras cassés lancés dans un cambriolage aux airs de chasse au trésor, où se succèdent péripéties loufoques et gags mal inspirés. Rarement narration n'a été aussi confuse, et à défaut de s'émerveiller devant une mise en scène soignée et homogène, on pourra s'attarder à repérer la patte des réalisateurs. Mais les codes ne suffisent pas à faire de bons films : on peut se risquer à dire que Triangle portait en lui les germes de l'incohérence, et la légèreté de traitement des auteurs l'a précipité dans l'abîme du cinéma... vain.
riangle est un projet aligné sur le principe du "cadavre exquis", à l'initiative du réalisateur Tsui Hark, qui s'est chargé d'écrire et réaliser la première partie, laissant la seconde à Ringo Lam, et la dernière à Johnnie To. L'affiche était prometteuse, ce qui rend la déception encore plus grande car Triangle n'est rien d'autre qu'une grosse marrade qui n'amuse que ses auteurs. L'histoire repose sur un trio de bras cassés lancés dans un cambriolage aux airs de chasse au trésor, où se succèdent péripéties loufoques et gags mal inspirés. Rarement narration n'a été aussi confuse, et à défaut de s'émerveiller devant une mise en scène soignée et homogène, on pourra s'attarder à repérer la patte des réalisateurs. Mais les codes ne suffisent pas à faire de bons films : on peut se risquer à dire que Triangle portait en lui les germes de l'incohérence, et la légèreté de traitement des auteurs l'a précipité dans l'abîme du cinéma... vain.
Le Voyage du Ballon Rouge, de Hou Hsiao Hsien, Taïwan
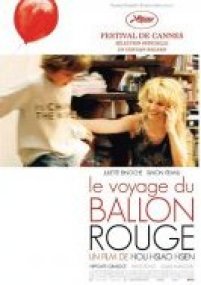 Pour apprécier le travail d’Hou Hsiao Hsien, il vaut mieux ne pas être allergique à sa mise en scène épurée et à ses sujets sociaux. Après Wong Kar Wai, Hou Hsiao Hsien tente lui aussi l’aventure du tournage à l’étranger, en l’occurrence ici Paris, et s’offre même notre Juliette Binoche nationale qui campe ici le rôle d’une comédienne travaillant pour une troupe de marionnettistes. Le film se veut dresser le portrait d’une femme esseulée et obligée d’employer une jeune étudiante chinoise pour s’occuper de son fils Simon. S’ajoute à cela des problèmes de voisinage (très drôles au demeurant) et une rupture difficile avec un mari expatrié. Contre toute attente, le casting (composé de certains comédiens totalement amateurs) fonctionne, et certains passages centrés autour du ballon rouge sont touchés par la grâce ; mais le sujet manque d’ambition, et l'on a déjà vu Hou Hsiao Hsien plus inspiré. En somme, un film intime qui devrait plaire aux fans du vétéran taiwanais.
Pour apprécier le travail d’Hou Hsiao Hsien, il vaut mieux ne pas être allergique à sa mise en scène épurée et à ses sujets sociaux. Après Wong Kar Wai, Hou Hsiao Hsien tente lui aussi l’aventure du tournage à l’étranger, en l’occurrence ici Paris, et s’offre même notre Juliette Binoche nationale qui campe ici le rôle d’une comédienne travaillant pour une troupe de marionnettistes. Le film se veut dresser le portrait d’une femme esseulée et obligée d’employer une jeune étudiante chinoise pour s’occuper de son fils Simon. S’ajoute à cela des problèmes de voisinage (très drôles au demeurant) et une rupture difficile avec un mari expatrié. Contre toute attente, le casting (composé de certains comédiens totalement amateurs) fonctionne, et certains passages centrés autour du ballon rouge sont touchés par la grâce ; mais le sujet manque d’ambition, et l'on a déjà vu Hou Hsiao Hsien plus inspiré. En somme, un film intime qui devrait plaire aux fans du vétéran taiwanais.
UN CERTAIN REGARD
Pleasure Factory, de Ekachai Uekrongtham, Thaïlande
 Autre belle surprise de ce Festival de Cannes, le second film du réalisateur thaïlandais Ekachai Uekrongtham, après le déjà très réussi et méconnu Beautiful Boxer. Le jeune auteur s’intéresse de près au quartier chaud de Singapour, dit le quartier rouge, où la prostitution fait vivre tout un microcosme de gens assez singuliers. Tourné caméra à l’épaule pour mieux renforcer un style lorgnant vers le documentaire, Uekrongtham suit deux jeunes hommes venus découvrir les plaisirs de la chair pour la première fois. Plutôt que de donner une vision manichéenne de la prostitution (le fameux regard policier), on ressent un réel attachement et une affection toute particulière du cinéaste pour ses personnages. Loin d’être pour autant un hymne à la prostitution, il démontre simplement comment ce commerce se vit de relations tout à fait saines mais aussi crapuleuses. Pleasure Factory est un brillant film sur la solitude, qui évite le misérabilisme, et surprend par son regard mature et éclairé sur un monde trop facilement caricaturé. Ekachai Uerkrongtham est un réalisateur à découvrir et à suivre avec beaucoup d’attention.
Autre belle surprise de ce Festival de Cannes, le second film du réalisateur thaïlandais Ekachai Uekrongtham, après le déjà très réussi et méconnu Beautiful Boxer. Le jeune auteur s’intéresse de près au quartier chaud de Singapour, dit le quartier rouge, où la prostitution fait vivre tout un microcosme de gens assez singuliers. Tourné caméra à l’épaule pour mieux renforcer un style lorgnant vers le documentaire, Uekrongtham suit deux jeunes hommes venus découvrir les plaisirs de la chair pour la première fois. Plutôt que de donner une vision manichéenne de la prostitution (le fameux regard policier), on ressent un réel attachement et une affection toute particulière du cinéaste pour ses personnages. Loin d’être pour autant un hymne à la prostitution, il démontre simplement comment ce commerce se vit de relations tout à fait saines mais aussi crapuleuses. Pleasure Factory est un brillant film sur la solitude, qui évite le misérabilisme, et surprend par son regard mature et éclairé sur un monde trop facilement caricaturé. Ekachai Uerkrongtham est un réalisateur à découvrir et à suivre avec beaucoup d’attention.
Blind Mountain, de Li Yang, Chine
Oeuvre qui traite de l'esclavage moderne dans la Chine profonde du début des années 90 à travers la destinée pénible d'une jeune étudiante vendue à son insu comme épouse dans un village de paysans isolé de tout... Réalisé très sobrement, tout en plans fixes, et monté sans musique, le film de Li Yang recherche la justesse du réalisme afin de favoriser l'immersion dans ce drame social inspiré de faits réels. Nous nous retrouvons alors face à un film efficace retranscrivant une atmosphère rurale obscurantiste et reculée tout à fait crédible : l'histoire est axée sur le personnage féminin Bai Xuemei, interprété magistralement par la jeune Lu Huang (performance laissant augurer une belle carrière) qui, par son refus de se soumettre à ses acquéreurs, voit sa condition glisser brutalement vers la captivité. Les tentatives d'évasion qui suivent contribuent à la gestation d'un final sec et désespéré mais ô combien jubilatoire. Blind Mountain est un véritable film de survie à ne pas rater.
Night Train, de Yinan Diao, Chine
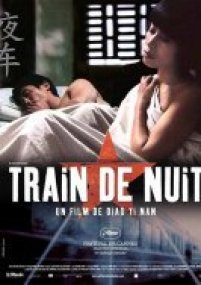 Le cinéma chinois est un gigantesque paradoxe : d’un côté, des films de costumes mégalomanes qui abreuvent le marché occidental, et de l’autre des petits films d’auteurs qui passent inaperçus, boudés par un public les jugeant trop longs, trop laconiques, et élitistes. Alors certes Night Train est un petit film d’auteur tourné à la DV et peu porté sur le dialogue ; mais il serait réducteur d’en rester là, avec un film d'une telle qualité. L’histoire est celle d’une femme bourreau qui travaille dans le milieu juridique horriblement austère d’une grande métropole de la province chinoise. En proie à la solitude la plus totale, elle cherche "l’âme sœur" via des rencontres matrimoniales qui pourraient la dégager de sa morne existence. Yinan Diao signe un film intriguant qui porte un regard "critique" mais politiquement correct sur la peine de mort et le destin d’une femme livrée à elle-même. Des longueurs parasitent le film mais le portrait de cette femme noyée dans un système rigide offre des moments de noirceur relativement intéressants.
Le cinéma chinois est un gigantesque paradoxe : d’un côté, des films de costumes mégalomanes qui abreuvent le marché occidental, et de l’autre des petits films d’auteurs qui passent inaperçus, boudés par un public les jugeant trop longs, trop laconiques, et élitistes. Alors certes Night Train est un petit film d’auteur tourné à la DV et peu porté sur le dialogue ; mais il serait réducteur d’en rester là, avec un film d'une telle qualité. L’histoire est celle d’une femme bourreau qui travaille dans le milieu juridique horriblement austère d’une grande métropole de la province chinoise. En proie à la solitude la plus totale, elle cherche "l’âme sœur" via des rencontres matrimoniales qui pourraient la dégager de sa morne existence. Yinan Diao signe un film intriguant qui porte un regard "critique" mais politiquement correct sur la peine de mort et le destin d’une femme livrée à elle-même. Des longueurs parasitent le film mais le portrait de cette femme noyée dans un système rigide offre des moments de noirceur relativement intéressants.
SEANCE SPECIALE MINUIT
Young Yakuza, de Jean-Pierre Limosin, France
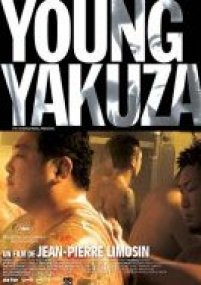 Le réalisateur français de Tokyo Eyes revient en force cette année avec un documentaire intéressant sur la pègre japonaise. On suit donc le parcours initiatique d’une jeune recrue au sein de l’un des nombreux clans de la capitale nipponne. Avec une mise en scène sobre et efficace, Limosin se fait témoin du quotidien quasi monastique du clan, dont les aspirants yakuzas s’acquittent des taches ménagères et sont entièrement dévoués à leur chef qu’ils considèrent comme un "nouveau père". Ce dernier se livre sans hésitation à la caméra dans de longs monologues expliquant sa vision personnelle du milieu et sa raison d’être dans la société japonaise actuelle. A aucun moment le cinéaste ne porte un regard dénonciateur sur ses "personnages" ; Limosin se contente d'observer avec attention cet univers criminel énigmatique. Le film est ponctué de performances rap du groupe RGM dont les paroles résonnent comme un écho à la vie du jeune enrôlé. Un documentaire rare, et en un mot : puissant.
Le réalisateur français de Tokyo Eyes revient en force cette année avec un documentaire intéressant sur la pègre japonaise. On suit donc le parcours initiatique d’une jeune recrue au sein de l’un des nombreux clans de la capitale nipponne. Avec une mise en scène sobre et efficace, Limosin se fait témoin du quotidien quasi monastique du clan, dont les aspirants yakuzas s’acquittent des taches ménagères et sont entièrement dévoués à leur chef qu’ils considèrent comme un "nouveau père". Ce dernier se livre sans hésitation à la caméra dans de longs monologues expliquant sa vision personnelle du milieu et sa raison d’être dans la société japonaise actuelle. A aucun moment le cinéaste ne porte un regard dénonciateur sur ses "personnages" ; Limosin se contente d'observer avec attention cet univers criminel énigmatique. Le film est ponctué de performances rap du groupe RGM dont les paroles résonnent comme un écho à la vie du jeune enrôlé. Un documentaire rare, et en un mot : puissant.
QUINZAINE DES REALISATEURS
Ploy, de Pen-ek Ratanaruang, Thaïlande
 Sixième film en dix ans pour le thaïlandais Pen-ek Ratanaruang, Ploy est une œuvre qui mène à la réflexion en nous proposant de rentrer dans l’intimité d’un couple l’espace de quelques heures au sein d’un hôtel luxueux, lieu de transit impersonnel et intemporel par excellence qui exerce une sorte de pouvoir fantasmagorique aux dérives érotiques. Ploy dévoile les pulsions sexuelles et destructrices ressenties par un homme et une femme, mariés, amoureux (du moins en apparence) face à la tentation, matérialisée dans le visage (et le corps) d’une jeune inconnue post-adolescente. Pen-ek Ratanaruang plonge dans une atmosphère où fantasme et réalité se superposent pour mieux perdre ses protagonistes (et ses spectateurs). Son traitement des rapports humains et sentimentaux passe de la violence la plus basique à la douceur de la proximité de deux corps. Les comédiens se livrent totalement à la caméra dans ce huit clos existentialiste, l’ambiance générale oscillant entre du Wong Kar-Wai, dans sa contemplation des relations, et du David Lynch, dans sa complexité réalité/fantasme, le tout scellé par la maîtrise singulière du réalisateur.
Sixième film en dix ans pour le thaïlandais Pen-ek Ratanaruang, Ploy est une œuvre qui mène à la réflexion en nous proposant de rentrer dans l’intimité d’un couple l’espace de quelques heures au sein d’un hôtel luxueux, lieu de transit impersonnel et intemporel par excellence qui exerce une sorte de pouvoir fantasmagorique aux dérives érotiques. Ploy dévoile les pulsions sexuelles et destructrices ressenties par un homme et une femme, mariés, amoureux (du moins en apparence) face à la tentation, matérialisée dans le visage (et le corps) d’une jeune inconnue post-adolescente. Pen-ek Ratanaruang plonge dans une atmosphère où fantasme et réalité se superposent pour mieux perdre ses protagonistes (et ses spectateurs). Son traitement des rapports humains et sentimentaux passe de la violence la plus basique à la douceur de la proximité de deux corps. Les comédiens se livrent totalement à la caméra dans ce huit clos existentialiste, l’ambiance générale oscillant entre du Wong Kar-Wai, dans sa contemplation des relations, et du David Lynch, dans sa complexité réalité/fantasme, le tout scellé par la maîtrise singulière du réalisateur.
Foster Child, de Brillante Mendoza, Philippines
 Le réalisateur Brillante Mendoza, ancien décorateur pour le cinéma, aborde le thème de l’adoption dans son quatrième film Foster Child. Porté par l’interprétation tout en retenue et en émotion de Cherry Pie Picache, le long-métrage dresse le portait de Thelma, mère adoptive chargée par les services sociaux de Manille de garder des enfants abandonnés avant leur adoption officielle. Dans un style proche du documentaire, Brillante Mendoza décrit son dur labeur... Nous l’accompagnons alors, des quartiers pauvres, en passant par les inévitables centres d’adoption, au dernier étage d’un grand et luxueux hôtel où patientent les futurs parents américains, vision d’un quotidien sans complaisance. Le décalage entre le travail acharné de Thelma et, finalement, le manque de considération, voire de reconnaissance en retour à ses efforts (par exemple lorsque sa patronne se vante auprès de la famille américaine des prix de "meilleure mère" dont est distinguée Thelma chaque fin d’année) semble être au cœur de la démarche de Brillante Mendoza. La force de son film réside définitivement dans son propos.
Le réalisateur Brillante Mendoza, ancien décorateur pour le cinéma, aborde le thème de l’adoption dans son quatrième film Foster Child. Porté par l’interprétation tout en retenue et en émotion de Cherry Pie Picache, le long-métrage dresse le portait de Thelma, mère adoptive chargée par les services sociaux de Manille de garder des enfants abandonnés avant leur adoption officielle. Dans un style proche du documentaire, Brillante Mendoza décrit son dur labeur... Nous l’accompagnons alors, des quartiers pauvres, en passant par les inévitables centres d’adoption, au dernier étage d’un grand et luxueux hôtel où patientent les futurs parents américains, vision d’un quotidien sans complaisance. Le décalage entre le travail acharné de Thelma et, finalement, le manque de considération, voire de reconnaissance en retour à ses efforts (par exemple lorsque sa patronne se vante auprès de la famille américaine des prix de "meilleure mère" dont est distinguée Thelma chaque fin d’année) semble être au cœur de la démarche de Brillante Mendoza. La force de son film réside définitivement dans son propos.
Dai Nipponjin, de Matsumoto Hitoshi, Japon

Matsumoto, immense star comique au Japon, réalise son premier film. Dai Nipponjin (littéralement "immense Japonais") raconte le quotidien de Dai Sato (joué par Matsumoto lui-même), défenseur de son pays issu d’une tradition familiale aux pouvoirs héréditaires. Suivi par une équipe télé (caméra épaule et style documentaire efficace), le personnage est méprisé par ses contemporains. Le mystère de Dai Sato (et de la nature du film) se dévoile dans un mix de Godzilla et Bioman où Matsumoto se transforme en géant armé d’un bâton pour éliminer les nuisibles. Place aux effets spéciaux et à l’humour aussi lourd que la taille de Dai Sato, pour une rupture totale avec le parti pris documentaire. Malgré quelques bonnes trouvailles, Dai Nipponjin lasse quelque peu, puisque trop convenu. Cette légère déception passée, on peut parier que Matsumoto pourrait s’engager dans une carrière à la reconnaissance internationale, à l’instar de son modèle de compétition Kitano.
MARCHE DU FILM
Nightmare Detective, de Tsukamoto Shinya, Japon
 Tsukamoto, le réalisateur le plus barré des années 90 (Tetsuo, Tokyo Fist, Bullet Ballet...) revient avec Nightmare Detective, thriller horrifique où un détective médium enquête sur une série de suicides provoqués par des cauchemars. Synopsis plutôt alléchant qui, bien que s'avérant être un film de commande, réserve des séquences et des idées de mise en scène sous acide mirobolantes. On retrouve dans le rôle du détective le jeune et talentueux comédien Matsuda Ryûhei (fils de Matsuda Yûsaku, révélé par Gohatto, bref celui-là même qui brillait dans les excellents 9 Souls et Blue Spring de Toyoda Toshiaki), dont la bonne prestation convainc immédiatement ; à l'inverse de Hitomi, ici la fliquette de service (évidemment en tailleur noir et talons hauts), piètre actrice dès la seconde où elle ouvre son bec. Et si par moment Tsukamoto se laisse aller à quelques facilités (des plans qui sentent bon la récup de ses premiers films), il ne faiblit pas quand il s’agit de filmer des scènes de meurtres dignes d’un giallo bien sadique, la sauvagerie en plus. Nightmare Detective, malgré ses passages essoufflés et sa mauvaise actrice (Hitomi, souvenez-vous en), possède suffisamment d’arguments en sa faveur pour enchanter les fans du réalisateur punk indus.
Tsukamoto, le réalisateur le plus barré des années 90 (Tetsuo, Tokyo Fist, Bullet Ballet...) revient avec Nightmare Detective, thriller horrifique où un détective médium enquête sur une série de suicides provoqués par des cauchemars. Synopsis plutôt alléchant qui, bien que s'avérant être un film de commande, réserve des séquences et des idées de mise en scène sous acide mirobolantes. On retrouve dans le rôle du détective le jeune et talentueux comédien Matsuda Ryûhei (fils de Matsuda Yûsaku, révélé par Gohatto, bref celui-là même qui brillait dans les excellents 9 Souls et Blue Spring de Toyoda Toshiaki), dont la bonne prestation convainc immédiatement ; à l'inverse de Hitomi, ici la fliquette de service (évidemment en tailleur noir et talons hauts), piètre actrice dès la seconde où elle ouvre son bec. Et si par moment Tsukamoto se laisse aller à quelques facilités (des plans qui sentent bon la récup de ses premiers films), il ne faiblit pas quand il s’agit de filmer des scènes de meurtres dignes d’un giallo bien sadique, la sauvagerie en plus. Nightmare Detective, malgré ses passages essoufflés et sa mauvaise actrice (Hitomi, souvenez-vous en), possède suffisamment d’arguments en sa faveur pour enchanter les fans du réalisateur punk indus.
First Flight, de Tanit Jitnukul, Thaïlande
 En 2000, le monde voyait en Tanit Jitnukul, réalisateur de Bangrajan, le renouveau du cinéma thaïlandais qui, bien entendu, n’arriva jamais. First Flight se passe peu avant la Première Guerre Mondiale, le héros de l'histoire est un jeune paysan rêvant de se faire enrôler dans la toute nouvelle unité de pilote de chasse, à savoir les vieux coucous de l’époque. Seul problème : cette école n’accepte que les élèves issus de la grande bourgeoisie. Le film relate donc le parcours du combattant de ce jeune effronté prêt à tout pour voler de ses propres ailes ; une comédie finalement assez basique qui multiplie les gags et les situations potaches à souhait qui font doucement sourire. Le film en devient même presque sympathique, si l’on accepte la naïveté du sujet et de ses personnages qui frisent parfois le ridicule, avec une mention spéciale au pilote instructeur français qui nous gratifie d’un accent hors du commun. Tanit Jitnukul n’est pas vraiment à l’aise dans la comédie, pas plus que dans l’action finalement, quand on voit la pauvreté de la séquence de guerre finale. Pas catastrophique pour autant mais pas mémorable non plus...
En 2000, le monde voyait en Tanit Jitnukul, réalisateur de Bangrajan, le renouveau du cinéma thaïlandais qui, bien entendu, n’arriva jamais. First Flight se passe peu avant la Première Guerre Mondiale, le héros de l'histoire est un jeune paysan rêvant de se faire enrôler dans la toute nouvelle unité de pilote de chasse, à savoir les vieux coucous de l’époque. Seul problème : cette école n’accepte que les élèves issus de la grande bourgeoisie. Le film relate donc le parcours du combattant de ce jeune effronté prêt à tout pour voler de ses propres ailes ; une comédie finalement assez basique qui multiplie les gags et les situations potaches à souhait qui font doucement sourire. Le film en devient même presque sympathique, si l’on accepte la naïveté du sujet et de ses personnages qui frisent parfois le ridicule, avec une mention spéciale au pilote instructeur français qui nous gratifie d’un accent hors du commun. Tanit Jitnukul n’est pas vraiment à l’aise dans la comédie, pas plus que dans l’action finalement, quand on voit la pauvreté de la séquence de guerre finale. Pas catastrophique pour autant mais pas mémorable non plus...
Paradise Murdered, de Kim Han-Min, Corée du Sud
 Pendant la projection de ce film, un sentiment assez palpable de lassitude et d’abrutissement général se faisait sentir. A croire que certains films de part leur nullité parviennent à vous clouer au siège, comme si l’écran émettait des ondes négatives pour venir vous anesthésier les neurones. Paradise Murdered est le premier film du réalisateur Kim Han-Min, qui raconte les déboires d’un village perdu sur une île, quelque part dans la galaxie. Une série de meurtres frappe alors cette petite communauté ; un docteur décide de mener son enquête, mais se retrouve alors très vite au centre des accusations. Mélange improbable entre comédie grinçante et thriller qui fait sourire les cinq premières minutes, Paradise Murdered devient très vite un calvaire. Il suffisait de tourner les yeux un instant pour se rendre compte que les témoins de ce spectacle tombaient comme des mouches, terrassés par l’ennui, et finalement par le sommeil. Chose incroyable, le film a accroché la première place du box office coréen… Comme quoi le cinéma recèle bien des mystères.
Pendant la projection de ce film, un sentiment assez palpable de lassitude et d’abrutissement général se faisait sentir. A croire que certains films de part leur nullité parviennent à vous clouer au siège, comme si l’écran émettait des ondes négatives pour venir vous anesthésier les neurones. Paradise Murdered est le premier film du réalisateur Kim Han-Min, qui raconte les déboires d’un village perdu sur une île, quelque part dans la galaxie. Une série de meurtres frappe alors cette petite communauté ; un docteur décide de mener son enquête, mais se retrouve alors très vite au centre des accusations. Mélange improbable entre comédie grinçante et thriller qui fait sourire les cinq premières minutes, Paradise Murdered devient très vite un calvaire. Il suffisait de tourner les yeux un instant pour se rendre compte que les témoins de ce spectacle tombaient comme des mouches, terrassés par l’ennui, et finalement par le sommeil. Chose incroyable, le film a accroché la première place du box office coréen… Comme quoi le cinéma recèle bien des mystères.
Protégé, de Derek Yee, Hong Kong
 Celui qu’on appréciait pour ses films intimistes réussis (Viva Erotica, C’est la vie mon Chérie), revient avec un casting de choix et un sujet prometteur. Andy Lau, Daniel Wu, Louis Koo et Anita Yuen viennent auréoler un film racontant les péripéties d’un caïd de la drogue au gang infiltré par un flic. Si le pitch n'a rien de très original dans ses grandes lignes, il opère, dans les détails, une sortie des sentiers battus en abordant parallèlement, et durement, le thème de l’addiction à la drogue, probablement sous l’influence de L’homme au Bras d’or d’Otto Preminger. Malheureusement le film est confus et s’égare assez rapidement dans une intrigue policière au rythme peu soutenu ; et si les acteurs font leur travail de façon honnête, ils ne comblent pas les lacunes d'un scénario insuffisamment solide. Dommage, car il y a une réelle volonté d'aborder un sujet finalement peu traité dans le cinéma de Hong Kong... la dimension polar du film finit par saborder le tout. A noter tout de même une séquence d’une barbarie digne d’un Catégorie 3, qui n’a au final rien à faire ici. Le film raconte deux histoires, et l’une d’entre elles est décidément de trop.
Celui qu’on appréciait pour ses films intimistes réussis (Viva Erotica, C’est la vie mon Chérie), revient avec un casting de choix et un sujet prometteur. Andy Lau, Daniel Wu, Louis Koo et Anita Yuen viennent auréoler un film racontant les péripéties d’un caïd de la drogue au gang infiltré par un flic. Si le pitch n'a rien de très original dans ses grandes lignes, il opère, dans les détails, une sortie des sentiers battus en abordant parallèlement, et durement, le thème de l’addiction à la drogue, probablement sous l’influence de L’homme au Bras d’or d’Otto Preminger. Malheureusement le film est confus et s’égare assez rapidement dans une intrigue policière au rythme peu soutenu ; et si les acteurs font leur travail de façon honnête, ils ne comblent pas les lacunes d'un scénario insuffisamment solide. Dommage, car il y a une réelle volonté d'aborder un sujet finalement peu traité dans le cinéma de Hong Kong... la dimension polar du film finit par saborder le tout. A noter tout de même une séquence d’une barbarie digne d’un Catégorie 3, qui n’a au final rien à faire ici. Le film raconte deux histoires, et l’une d’entre elles est décidément de trop.
La compétition officielle, qui était présidée cette année par le réalisateur britannique Stephen Frears, a vu couronner cette année deux films asiatiques, et pas des moindres, bien qu'ils n'aient pas convaincu la rédaction : La Forêt de Mogari de Kawase Naomi a remporté le grand prix du jury, et Jeon Do-yeon, l’actrice principale du Secret Sunshine de Lee Chang-dong, a reçu le prix d’interprétation féminine. Deux prix de taille qui devraient assurer une large distribution de ces deux films dans l’hexagone comme ailleurs. A noter dans ce palmarès la cruelle désillusion de Wong Kar-Wai qui repart bredouille, tenant dans ses mains les bobines d’un triste épisode de sa carrière. Destin identique pour le coréen damné Kim Ki-Duk, qui n’aurait pas du tout convaincu avec son film Soom. Pourtant, on ne peut que remercier un événement qui a, une fois de plus, permis la promotion d'un cinéma asiatique encore trop "étranger" aux yeux du public occidental...